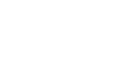L’élection d’un nouveau pape, Léon XIV, âgé de « seulement » 69 ans, laisse augurer que ce dernier – si Dieu lui prête suffisamment vie – devrait servir de « berger » au monde catholique pour les 10 à 15 prochaines années et montrer ainsi le « chemin » à ses fidèles jusqu’à l’horizon 2035/2040. En tant que figure religieuse et morale, le 267e souverain pontife va chercher à peser sur l’évolution du monde au travers de l’ influence qu’il est en mesure d’exercer sur le 1,4 milliard de catholiques actuellement recensé sur les cinq continents, mais aussi par le biais de ses futures encycliques qu’il consacrera à de grands problèmes mondiaux (sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques) et à ses prises de position sur divers dossiers géopolitiques.
Nul doute que ses interventions prendront en compte les évolutions démographiques qui se profilent, les innovations technologiques disruptives qui s’envisagent et les problèmes éthiques et philosophiques qui vont en résulter (diffusion de l’IA ; percées en matière de biotechnologiques ; innovations en génie génétique ou en neurosciences), sans oublier les effets, de plus en plus visibles, du dépassement des limites planétaires ni les évolutions des rapports de force entre grandes puissances mondiales, étatiques ou entrepreneuriales, en compétition pour le leadership mondial. La période de son pontificat s’annonce au moins aussi agitée que celle à laquelle fut confronté son prédécesseur, Léon XIII (1878-1903), lors de la seconde révolution industrielle au XIXe siècle, et qui conduisit ce dernier à rédiger des textes aussi remarquables que la célèbre encyclique Rerum novarum (« Des choses nouvelles », 1891), définissant la doctrine sociale de l’Église en réaction à l’évolution du monde d’alors, ou encore la lettre apostolique Testem Benevolentiae (« Témoin de notre bonne volonté », 1899) dénonçant les dangers – déjà – de « l’américanisme ».
Vers une Église toujours plus globalisée
La sagesse et le bon sens du Saint-Père (certains ajouteront l’appui de l’Esprit Saint) ne seront pas de trop pour l’aider à trouver une juste voie / voix dans un monde et une période qui s’annoncent des plus chaotiques. Il lui faudra influer, autant que faire se peut, sur l’implacable marche du monde, mais aussi et surtout adapter le catholicisme à tous ces bouleversements. Léon XIV va devoir accompagner certaines tendances qui se profilent déjà, et poursuivre l’œuvre engagée par François. Outre les questions spécifiques au bon fonctionnement de l’institution (tensions entre néo-traditionnalistes et progressistes, situation financière, baisse des vocations, mariage des prêtres, ordination des femmes, place des laïcs, attitude à l’égard des homosexuels lutte contre la pédocriminalité), il devra se pencher sur la « déseuropéanisation » de l’Église catholique, fortement impactée par la déchristianisation croissante des populations européennes et la marginalisation démographique en cours du Vieux Continent, tout en accompagnant un ancrage qui ne cesse de se consolider dans les « périphéries » du « Sud émergent ».
Cette double dynamique simultanée entraîne un déplacement du centre de gravité de l’institution et une évolution de grande ampleur : l’Église catholique, qui se présente depuis des siècles comme « universelle » tout en s’appuyant sur l’hégémonie occidentale, est en passe de devenir une institution de plus en plus globalisée et transcontinentale, mais minoritaire dans un monde qui, chaque jour davantage, doit s’envisager à l’aune d’un futur « post-occidental ». Une Église new look « (presque) partout présente, mais (presque) partout minoritaire », pour reprendre la formule de l’historien Denis Pelletier.
La primauté du catholicisme est concurrencée au sein du christianisme par la progression des diverses Églises protestantes, en particulier d’obédience pentecôtiste et évangélique. Mais au-delà des rivalités intra-chrétiennes, l’expansion mondiale de l’islam constitue « le » défi majeur. L’islam sunnite, avec son 1,8 milliard de fidèles estimés en 2025, s’affirme déjà comme le 1er courant religieux au monde. Et, à la lumière des projections démographiques, l’islam (sunnite + chiite) devrait se hisser au rang de 1re religion mondiale à l’horizon 2070, devant les diverses formes de christianisme (catholique, protestant, orthodoxe).
La modification des rapports de force religieux va constituer une des lignes de force de la scène internationale au cours des prochaines décennies. La prise en compte de ce phénomène a été au cœur de l’action du pape François. Ce dernier a entrepris de « globaliser » de façon spectaculaire le collège cardinalice, en créant durant son pontificat pas moins de 163 nouveaux cardinaux, issus de près de 80 pays, dont certains n’abritant qu’une toute petite minorité catholique comme la Suède, le Myanmar mais aussi le Bangladesh ou encore le Laos et la Malaisie. Une politique qui a entraîné une relative perte d’influence des cardinaux européens et un reformatage en profondeur du collège électoral lors du récent conclave : sur les 135 cardinaux électeurs en droit de voter (âgés de moins de 80 ans), 108 ont été créés par François sur la base de critères relatifs à sa vision du devenir de l’Église.
Alors que les cardinaux européens représentaient les 2/3 des électeurs lors du conclave de 1963 ayant élu Paul VI (53 sur 80), dont plus d’un tiers d’Italiens (contre un seul cardinal africain à l’époque), ces derniers ne représentaient plus que 39 % des électeurs lors du dernier conclave (toujours 53 mais désormais sur 135). En ajoutant les 14 cardinaux nord-américains et australiens, les « Occidentaux » ont frôlé une bien frêle majorité. Un étiolement de l’hégémonie cardinalice occidentale observable au fil des trois conclaves organisés depuis les années 60 (1978, 2005 et 2013), mais qui a été sensiblement amplifié par l’action de François. Ce dernier n’a pas ménagé ses efforts en la matière durant son pontificat, en doublant le nombre de cardinaux électeurs asiatiques (23 en 2025, soit 17 % du collège électoral, un nombre équivalent à ceux d’Amérique latine), et en augmentant de 80 % celui des Africains (18 en 2025, soit 13,3 % des cardinaux électeurs). En dépit de ce volontarisme, l’Afrique, qui représente dorénavant environ 20 % des fidèles selon le Vatican, soit autant que l’Europe, souffre encore d’une sous-représentation chronique que le futur pape devra s’employer à combler tout en maintenant l’effort en direction de l’Asie, et tout particulièrement de la Chine, « la » cible missionnaire du futur par excellence…
Ce mouvement tellurique qui affecte le sommet du clergé catholique se ressent également à sa base. Face à la baisse des vocations et à la pénurie de jeunes prêtres alors que le vieillissement du clergé est chaque jour plus problématique, nombre de paroisses européennes sont désormais confiées à des prêtes issus des « périphéries » : béninois ou congolais en France, nigérians ou ghanéens en Irlande, latino-américains dans la péninsule ibérique. La presse rapportait récemment que dans la très catholique Irlande, la « crise de foi » était si profonde qu’ à l’été 2024, il n’y avait plus qu’un seul séminariste se préparant au sacerdoce dans toute l’agglomération de Dublin. Même dans l’île consacrée à Saint Patrick, l’importation de prélats « périphériques » est devenue une nécessité. La « bascule au sud » ne se remarque pas qu’à la Curie, mais aussi, au coin de sa rue…
Un nouveau pontife « panaméricain », au profil syncrétique
Pour faire face au tsunami de défis qui l’attend, Robert Francis Prevost, alias « Father Bob » à Chicago, « Padre Roberto » au Pérou ou encore « Yankee Latino » à Rome mais dorénavant connu comme Léon XIV sur la planète entière, dispose de quelques atouts.
Si beaucoup de commentateurs ont insisté sur sa nationalité américaine et interprété son élection – selon une vision très occidentalo-centrée – comme une manœuvre visant à établir un contre-pouvoir made in America à la gouvernance erratique du président Trump et un contre-feu à l’idéologie MAGA (en particulier sur la question de l’immigration), d’autres clefs d’analyse mériteraient une plus grande attention. Et singulièrement son autre nationalité, péruvienne, acquise en 2015. Une nationalité obtenue ni par le sang, ni par le sol, mais par une volonté personnelle de se rapprocher de ses ouailles dans le cadre de son engagement missionnaire. Celui-ci l’a conduit à passer près de 30 ans au Pérou, au gré de divers séjours à compter de 1985, le dernier l’ayant propulsé, en 2014, à la charge d’évêque du diocèse de Chiclayo, la 5e ville du pays, dans ce que l’on pourrait appeler le « Sud émergent profond ».
S’il est unanimement présenté comme le premier pape nord-américain, on peut également le qualifier de second pape latino-américain, en digne successeur de l’Argentin Jorge Bergoglio. Certains commentateurs le présentent même comme un pape « panaméricain ». Un prélat en provenance d’un pays andin remplace un prélat du Cône Sud. Un passage de témoin qui souligne, au détriment de l’Europe, le poids crucial de l’Amérique latine dans l’Église contemporaine. Une telle présentation des faits n’a guère été usitée dans les médias occidentaux, mais a été largement mise en avant au Pérou ainsi que dans de nombreuses catholicités du « Sud global ».
Son appartenance à l’ordre des augustiniens constitue un autre « détail » un peu trop négligé par les commentateurs mainstream occidentaux. Cet ordre mendiant s’est réorienté au cours du XIXe siècle vers le travail missionnaire dans des contextes humains et culturels très diversifiés. Des missions augustiniennes sont présentes dans près de 50 pays, principalement en Asie, Afrique et Amérique latine. Robert Francis Prevost a servi comme prieur général de l’ordre de juin 2001 à septembre 2013. Il a donc eu pour mission de gérer, depuis Rome, un réseau de quelque 2500 membres (frères, sœurs, laïcs) déployés à travers la planète, mais surtout dans le Sud émergent, souvent dans des environnements marqués par la violence, la pauvreté et l’injustice. À ce titre, il a été amené à superviser leur travail quotidien sur plusieurs fronts missionnaires majeurs, comme les Philippines, le Vietnam, la RDC et le Nigeria – autant de pays que les projections démographiques à l’horizon 2050 placent tout en haut de la liste des bastions catholiques de ces temps à venir. Rappelons que la population philippine devrait s’élever à 170 millions de personnes en 2060, à 80, voire 90 % de confession catholique. Le nouveau pape travaille ainsi depuis des années à forger, sur le terrain ou à Rome, l’avenir du catholicisme !
Une tâche confortée par sa nomination, au début de la décennie 2020, en tant que préfet du dicastère pour les évêques. Le titulaire de cette fonction a pour charge de ciseler la colonne vertébrale de l’Église incarnée par les quelque 5430 évêques répartis sur tous les continents. Et – accessoirement – de présélectionner ceux qui deviendront les futurs cardinaux appelés à voter lors du prochain conclave…
La célérité avec laquelle le récent conclave a plébiscité – à la surprise de nombreux commentateurs – le cardinal Prevost, au détriment de candidats jugés plus favoris (comme l’italien Pietro Parolin ou le philippin Luis Antonio Tagle) doit beaucoup au profil hybride et syncrétique de cet « Occidental sudiste ». En retenant son profil de citoyen du monde polyglotte (il parle 5 langues), ses pairs ont confirmé son statut d’étoile montante de l’Église, dont témoigne l’extrême rapidité de sa progression au sein de la hiérarchie vaticane et de la Curie. Nommé préfet du dicastère des évêques en janvier 2023, créé cardinal en septembre 2023, il est élu pape en mai 2025, soit à peine 19 mois après avoir obtenu la pourpre cardinalice. Une telle « performance » n’avait pas été observée au sein de la Curie depuis Pie XI, dans les années 20 !
***
Ainsi, une assemblée de 133 électeurs originaires de 70 pays, que d’aucuns auraient présentés majoritairement comme des « vieillards » pétris de références très occidentalo-centrées et opérant le cadre d’une pompe quasi-médiévale, est parvenue en à peine 4 tours de scrutin (soit à peine plus d’un jour de conclave) à identifier l’un des siens comme affichant le profil le plus adéquat pour « montrer le chemin » au regard des formidables transformations qui attendent l’Église au cours des prochaines années, dans un monde toujours plus globalisé et post-occidental. Et cela sans céder à la tentation d’un conservatisme suicidaire et d’un traditionalisme nostalgique. Cet étonnant paradoxe (que certains interpréteront comme un signe de la Providence) témoigne que l’innovation et la compréhension de la modernité n’ont pas de limite d’âge. Décidément, les voies du Seigneur sont bien impénétrables !