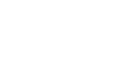Dans le flot d’annonces disruptives et de petites phrases agressives à l’encontre de ses alliés – souvent suivies de rétropédalages, parfois très rapides – qui ont marqué les 50 premiers jours de la présidence Trump, il est un événement passé relativement inaperçu dans les médias mainstream : ce qu’il convient de nommer l’annonce de « l’américanisation » de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation), le principal fabricant mondial de microprocesseurs. Ses fameuses puces constituent les « briques élémentaires » de l’économie moderne et encore plus de celle du futur. Elles font office de « composants fondamentaux » de l’économie digitale et hautement technicisée dans laquelle nous basculons toujours plus, jour après jour ; des éléments cruciaux tout autant pour l’essor de l’intelligence artificielle, l’amélioration des équipements de défense, le développement de la mobilité électrique ou encore le bon fonctionnement des réseaux d’objets connectés qui peuplent notre quotidien.
Le deal de l’année (voire de la décennie)
Dans le tumulte provoqué par les errements de la Maison-Blanche dans le dossier ukrainien, les polémiques relatives au démantèlement programmé de l’essentiel de l’État fédéral ou les rebondissements variés de la guerre tarifaire engagée contre le Canada, le Mexique, la Chine et l’UE, l’annonce faite par C. C. Wei, le PDG de TSMC, lors d’une rencontre avec le président Trump dans le Bureau ovale le 3 mars derniern’a eu qu’un écho médiatique inversement proportionnel à son importance, pourtant réellement capitale : un événement en passe de formater, sous nos yeux inattentifs, un vaste pan du monde à venir… Cette réunion n’entérinait rien de moins que la transplantation sur le sol américain d’un écosystème high tech complet – et absolument vital – dans la Tech War opposant Washington à Pékin. Un exemple de tuilage parfait des efforts bipartisans US en la matière, engagés lors du 1er mandat Trump, poursuivis par l’administration Biden et concrétisés par l’administration Trump II, laquelle a pu bénéficier de tout le travail amont réalisé par ses prédécesseurs, via le CHIPS & Science Act. Du travail d’orfèvre !
Faussement accusés par Trump, à plusieurs reprises, « d’avoir volé » l’industrie américaine des semi-conducteurs et menacés de subir les foudres tarifaires trumpistes, les Taïwanais ont rapidement cédé aux exigences de Washington. TSMC s’engage ainsi à construire en Arizona, au cours des 4 prochaines années, pas moins de trois nouvelles usines ultramodernes, deux installations d’emballage avancé et un centre de recherche et de développement dernier cri, soit un investissement de 100 Mds$. Un chiffre rond comme les aime Donald Trump, censé donner lieu à la création d’au moins 6000 emplois dans le secteur de la High Tech et 20 000 dans celui de la construction. Un engagement majeur, qui s’ajoute aux 65 Mds déjà investis par la firme taïwanaise depuis 2020 dans cet État du sud des États-Unis sous forme d’une première usine de fabrication de processeurs (Fab 21) qui emploie désormais 3000 personnes à Phœnix et dont la production a démarré fin 2024. Cette implantation s’est accompagnée de celle de dizaines de sous-traitants, américains ou taïwanais, du n°1 mondial.
De tels projets permettent à la direction de la communication de TSMC d’évoquer le « plus grand investissement étranger direct de l’histoire américaine » et à certains analystes de parler de la constitution d’une CHIPS Valley, pendant arizonien de la Silicon Valley californienne, et atout majeur dans la compétition pour la suprématie technologique mondiale. De quoi inciter certains commentateurs à considérer que ce deal constitue – de très loin – l’action la plus marquante des multiples initiatives engagées par l’administration Trump depuis son arrivée au pouvoir, celle qui sera la plus conséquente dans les domaines géopolitique et géoéconomique, et la plus à même de peser sur l’équilibre effectif des rapports de force, militaire, économique et technologique mondiaux dans les années futures.
Une redistribution majeure des cartes à venir
L’ampleur de ce projet en fait indiscutablement un game changer pour toute l’industrie mondiale du semi-conducteur. À compter de 2026, les trois nouveaux sites de fabrication prévus en Arizona sont destinés à produire les puces les plus performantes de TSMC, reposant sur la technologie « A16 », avant de réaliser des puces de seulement 2 nanomètres d’ici la fin de la décennie 2030 (contre 12 nanomètres pour les puces made in USA les plus performantes actuellement). Mais l’actif le plus stratégique de l’accord du 3 mars repose sur les deux installations d’emballage de pointe. De prime abord, pour les techno-béotiens que nous sommes (presque) tous, pas de quoi s’emballer particulièrement. Sauf que de telles installations sont cruciales, car elles simplifient – d’un point de vue technique et logistique – une opération complexe, jusqu’à présent très largement réalisée en Asie, y compris pour les puces fabriquées aux États-Unis. Il s’agit d’empiler les puces les unes sur les autres, de leur ajouter des connexions puis de les intégrer aux appareils auxquels elles sont destinées : ordinateurs, smartphones, consoles de jeux, équipements connectés divers et variés. La maîtrise de cette étape va permettre d’assurer la quasi-intégralité du processus de fabrication sur le sol états-unien, hors de portée de la menace chinoise.
Une telle concentration de capacités de production, d’emballage et de recherche au cœur de l’Arizona devrait favoriser une accélération des cycles d’innovation et de production pour répondre au mieux aux besoins d’Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm et, au-delà, à leurs clients finaux respectifs (Amazon, Meta, Open AI). Avec, pour résultat, de sécuriser une grande partie de leurs chaînes d’approvisionnement – à un niveau bien plus élevé qu’actuellement – et de garantir la stabilité de leur production. Celles-ci, dans un avenir proche, seront ainsi en mesure d’échapper à de nouvelles turbulences en cas de nouvelle crise épidémique mondiale ou de tumultes géopolitiques, en particulier dans la zone indo-pacifique.
Au-delà de son côté foutraque et de ses rodomontades expansionnistes concernant le Canada ou le Groenland, l’administration Trump sait – parfois – être diaboliquement efficace. Le dossier TSMC en est la meilleure illustration. Par ce coup de maître, Washington obtient la relocalisation d’une bonne partie des capacités de production du Taïwanais, jusqu’à présent situées à seulement 180 km des côtes chinoises, à près de 11 500 km de celles-ci. Un exemple « parfait » de mitigation du risque géopolitique !
Au moins deux sérieux obstacles à surmonter
Restent néanmoins à clarifier deux ombres à ce tableau presque idyllique :
- assurer la fourniture en eau, nécessaire en grande quantité pour la fabrication des puces, à ce formidable écosystème technologique, sa localisation dans le très aride et très ensoleillé Arizona n’aidant pas particulièrement à la résolution de ce défi. Il est probable que des transferts d’eau supplémentaires en provenance du Colorado soient envisagés, mais les ressources hydriques du bassin du principal fleuve de l’Ouest américain ne sont pas illimitées et les autres États riverains du bassin pourraient ne pas accepter de nouvelles ponctions en leur défaveur. De même, l’optimisation des rares ressources hydriques locales devraient se heurter à des limites physiques (surexploitation des eaux souterraines, maigre débit des rivières locales, timide programme de recyclage des eaux usées). Un « facteur de blocage » à suivre, illustrant la finitude des ressources de notre planète au regard des grands projets prométhéens, qu’ils soient technologiques et/ou géopolitiques ;
- trouver suffisamment de mains-d’œuvre locales compétentes et travailleuses (à l’aune des normes taïwanaises…), ce qui est tout sauf gagné tant l’écart culturel entre Américains et Taïwanais au sujet de la valeur « travail » semble grand. TSMC, lors de l’installation de sa toute première usine, entre 2020 et 2024, a rencontré les pires difficultés à recruter en quantités suffisantes des employés US « adaptables » à ses normes de fonctionnement et de management, qu’il s’agisse de supporter la charge de travail demandée (dans sa biographie, le fondateur de TSMC, Morris Chang, rappelle qu’au démarrage de la firme, à la fin des années 1980, certains ingénieurs taïwanais atteignaient les 80 heures de travail par semaine) ou de compétence technique (la formation scientifique de base des diplômés états-uniens laissant souvent à désirer aux yeux de l’encadrement asiatique). Si bien que la firme a dû « importer » près d’un millier d’ingénieurs et de techniciens insulaires et leurs familles en Arizona pour tenir les délais et préserver la qualité de la production. Ce problème devrait de nouveau se poser à la puissance 3 ou 4, en tenant compte d’un climat politique et administratif américain nettement moins propice à l’importation de main-d’œuvre étrangère. Restera également à TSMC à trouver le nombre nécessaire de candidats à l’expatriation dans l’Amérique trumpiste, et cela alors qu’un flot croissant et préoccupant d’anciens cadres et ingénieurs de TSMC rejoignent des firmes chinoises continentales.
Pour peu que ces deux obstacles soient surmontés, cet ambitieux projet devrait se concrétiser au cours de la seconde moitié de la décennie 2030 et reconfigurer en profondeur toute l’industrie mondiale du semi-conducteur, en y renforçant considérablement la position déjà dominante de TSMC. En concluant cet accord, la firme basée à Hsinchu sécurise une bonne partie de ses actifs industriels et de son savoir-faire hors de portée d’un coup de force de Pékin, tout en s’insérant, massivement (165 Mds$ !), au sein de la High Tech américaine, quitte à subrepticement changer de facto de pavillon (certains facétieux commentateurs renommant TSMC « ASMC », A comme America ou Arizona selon les versions…). Cette implantation sur son principal marché lui permet enfin de s’émanciper d’un cadre insulaire limitatif en matière de ressources foncières, énergétiques, hydriques, voire humaines – à la plus grande satisfaction de ses actionnaires et de l’exécutif américain.
Un projet win/win qui va pourtant faire des perdants
Mais cette nouvelle donne « techno-politique » va faire (au moins) deux grands perdants :
- le premier est Intel, le principal rival états-uniens de TSMC, déjà nettement dépassé par les performances actuelles du Taïwanais et qui ne cesse de s’enfoncer dans la crise, incapable de tenir la cadence en matière d’innovation et de production imposée par son rival. « L’américanisation » de ce dernier pourrait lui porter le coup de grâce. La nomination, mi-mars, d’un nouveau directeur général, Lip-Bu Tan, en remplacement de Pat Gelsinger (mis à l’écart fin 2024 pour résultats insuffisants), constitue la dernière chance de remonter la pente. Elle a été plutôt bien accueillie au sein des marchés, mais la pente est très raide et les scénarii les plus pessimistes continuent à être explorés par les analystes financiers. En dépit d’un secteur en plein boom (essor de l’IA, relance des commandes militaires, besoins en connectivité tous azimuts, transition énergétique), Intel a enregistré l’année dernière sa première perte en près de 20 ans d’activité, accentuant un repli massif de son cours en Bourse. Ses marchés historiques (fourniture de puces CPU pour les serveurs et les ordinateurs) se dérobent, en raison d’une gamme de produits n’ayant pas su se renouveler et d’une relative stagnation technologique. L’entreprise a raté ces dernières années le virage du smartphone puis le tournant de l’IA et a accumulé des choix stratégiques peu pertinents. Sa nouvelle activité, la fonderie, sur laquelle misait grandement Gelsinger à son lancement en 2021, s’avère largement déficitaire tandis que ses efforts pour se positionner sur le marché des cartes graphiques dédiées à l’IA se heurtent à une féroce concurrence. Face à un tel panorama, la capacité de l’entreprise à survivre à terme commence à faire débat. Plusieurs scénarii de rachat ou de scission, impliquant diverses firmes US mais aussi TSMC, ont été envisagés ces derniers mois, une vente à la découpe des diverses activités apparaissant comme l’hypothèse la plus probable si l’opération de la dernière chance lancée sous la supervision de Lip-Bu Tan échoue dans les mois à venir. TSMC semble travailler sur un projet de reprise des activités de fonderie d’Intel, en partenariat avec des firmes américaines déjà clientes (Qualcomm, ARM) et des fonds d’investissement US (Apollo Global Management, Silver Lake). Un montage qui nécessite impérativement le feu vert de la Maison-Blanche en raison des liens étroits entre Intel et le Pentagone : « l’américanisation » de TSMC ne doit pas s’accompagner de la « taïwanisation » d’Intel… America First !
- Mais le plus grand perdant de la manœuvre est cours s’avère incontestablement Taïwan. Sa fidélité à Washington face à la menace chinoise ne va guère être récompensée et l’île redoute (très lucidement) que « l’américanisation » à venir de TSMC ne se traduise à la fois par la perte d’un actif économique de première importance mais aussi – et avant tout – par l’affaiblissement de son Silicon Shield, son bouclier technologique et stratégique primordial, sa garantie suprême anti-invasion et anti-blocus au nom de laquelle Washington serait intervenu pour ainsi dire automatiquement en cas de coup de force de Pékin contre l’île. Une fois cet atout très largement délocalisé en Arizona, quelle sera l’attitude de Washington, tout du moins de l’administration Trump, au cours des prochaines années ? Le locataire de la Maison-Blanche prendra-t-il le risque de s’engager dans un conflit – possiblement de haute intensité – avec la Chine au sujet de l’île séparatiste, à la valeur techno-stratégique bien minorée ? Sera-t-il enclin à faire la guerre à Pékin pour défendre un « simple » bastion avancé démocratique face à l’appétit du géant continental ? Au vu de la fiabilité affichée par Trump à l’égard de ses alliés, rien n’est moins sûr ! À moins de payer, toujours plus cher, la garantie sécuritaire US. Le slogan « Ukraine aujourd’hui, Taïwan demain » s’est profondément immiscé dans l’esprit de nombreux insulaires ces dernières semaines.
Même si TSMC ne cesse de répéter que la grande majorité de ses actuelles gigafabs seront maintenues dans l’île, son choix américain est loin de faire l’unanimité au sein de l’opinion taïwanaise, massivement contre un tel projet. Il est également vivement critiqué par le principal parti d’opposition, le Kuomintang (KTM), qui dénonce avec vigueur le pillage technologique et l’accaparement d’un élément vital de l’économie insulaire par le « Grand Allié ». Une telle « trahison » n’a pas tardé à relancer, dans l’île, le débat sur l’acquisition de l’arme nucléaire, au cas où…
L’exécutif taïwanais apparaît désarmé (et déboussolé) par la manœuvre engagée par la firme de Hsinchu, n’ayant guère de marge de manœuvre face à l’imprévisible président américain, toujours prompt à dégainer des menaces tarifaires ou de réduction de son aide militaire. Le gouvernement de Taïpei entend toutefois scruter attentivement l’accord de TSMC pour vérifier s’il est bien « en conformité avec la loi » (qui n’autorise la production à l’étranger que de puces ayant au moins deux générations de retard sur les semi-conducteurs les plus avancés produits dans le pays) et compte s’assurer que les processus de fabrication de puces « les plus avancés » en matière de finesse de gravure resteront bien dans l’île. Le genre de formulation qui n’engage que ceux qui y croient dans le monde qui se profile à l’horizon 2035.
*
* *
Ce « coup de maître » (vu de Washington) ou coup de force (vu de Taïpei) au détriment d’un fidèle allié est-il la préfiguration de ce qui attend – cette fois dans le registre géopolitique – le tout aussi fidèle Danemark concernant le Groenland, voire – pour les plus pessimistes – l’encore plus fidèle Canada, tout simplement menacé par une sorte d’Anschluss made in USA ? À qui le tour de passer sous les fourches caudines trumpistes ? Préparons-nous à devoir encaisser de nouvelles sidérations stratégiques. En ce 1er quart finissant du XXIe siècle, la réalité semble avoir encore moins de limites que la fiction !