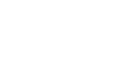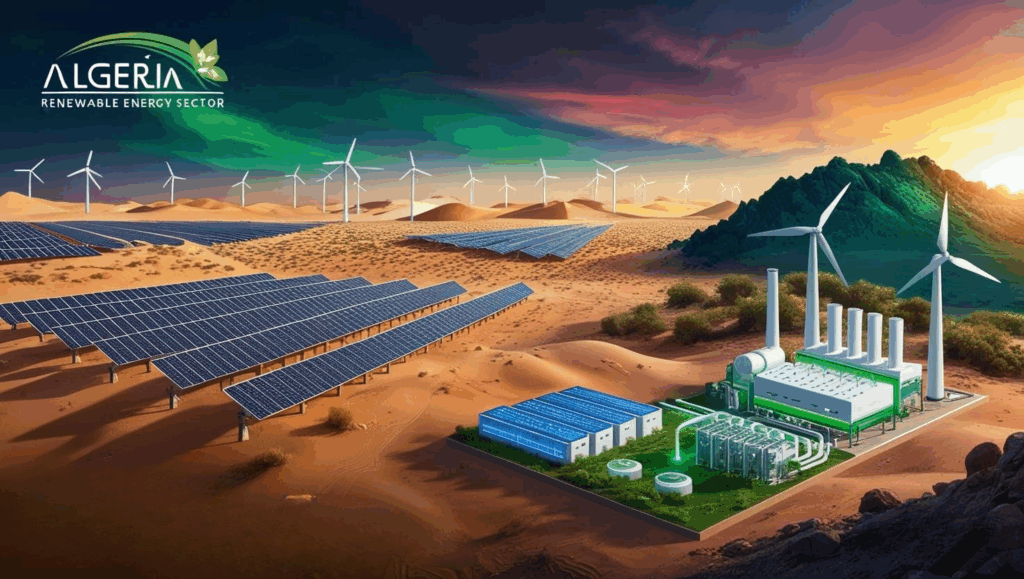Alors que Paris et Alger se sont engagés dans une escalade diplomatique englobant rancœurs du passé, irritation géopolitique contemporaine (reconnaissance par la France de la « marocanité » du Sahara occidental), instrumentalisation d’affaires judiciaires et discours incantatoires sur fond d’ambitions politiques, le ministre français des Affaires étrangères a sollicité à plusieurs reprises le soutien de ses partenaires européens…. Lequel risque de ne jamais venir ! Outre une très forte réticence à s’impliquer dans un bras de fer post-colonial qui n’intéresse que les deux capitales, nombre de pays européens voient en l’Algérie un précieux partenaire économique et énergétique avec lequel ils ont tissé des relations étroites, appelées à s’intensifier au cours des prochaines années. Une telle évolution s’explique au regard de la volonté d’Alger de tirer profit de son très important potentiel en énergies renouvelables alors que l’Europe s’engage dans une délicate transition énergétique. C’est cette nouvelle perspective de la relation euro-algérienne qu’explore cette contribution de Bassem Laredj qu’Horizon 2035 est heureux d’accueillir de nouveau. Bassem est docteur en droit international, analyste stratégique et enseignant universitaire en Droit international et Relations internationales. Il est également président- fondateur du cabinet de conseil Amane Risk Consulting, spécialisé en Renseignement d’affaires et Risque pays.
***
Acteur clé du marché international du gaz naturel (7ᵉ mondial en matière du volume exporté en 2023), l’Algérie pourrait également devenir, dans les prochaines décennies, un acteur clé dans le domaine des énergies renouvelables (EnR) et propres, notamment dans l’espace méditerranéen et africain.
Si, pendant longtemps, le développement de ces énergies n’était pas la priorité des pouvoirs publics en raison de l’abondance et du faible coût des énergies extractives, la situation semble changer aujourd’hui. En dehors des questions liées à la protection de l’environnement, deux éléments principaux peuvent expliquer ces nouvelles ambitions.
D’abord, il y a la nécessité d’aller graduellement vers une transition énergétique afin de diversifier les sources d’énergie du pays (et ainsi préserver au maximum ses capacités d’exportation gazière) et de répondre efficacement à l’augmentation continue de la demande locale en énergie. Ensuite, il y a l’urgence de s’adapter aux nouvelles réalités du marché énergétique mondial, notamment vis-à-vis du voisin européen, son principal client, dont les choix énergétiques ont un impact direct sur l’Algérie. La volonté de l’Union européenne d’abandonner progressivement les énergies fossiles dans son mixte énergétique impose en effet à l’Algérie d’anticiper les prochaines évolutions de ce marché pour être en mesure de conserver et renforcer sa position de fournisseur énergétique majeur de l’Europe. Pour ce faire, l’Algérie semble de plus en plus miser sur le développement des énergies renouvelables et propres, notamment le solaire et l’hydrogène vert.
Un potentiel solaire parmi les plus importants au monde
Plus grand pays africain et arabe par sa superficie, l’Algérie dispose d’un des gisements solaires les plus importants au monde. La durée d’insolation sur la quasi-totalité du territoire national dépasse les 2 000 heures annuelles, et peut atteindre les 3 900 heures dans les hauts plateaux et le Sahara, qui couvrent plus de 80 % de la superficie du pays. L’énergie reçue annuellement sur une surface horizontale de 1 m² est ainsi de près de 3 KWh/m² au nord et dépasse 5,6 KWh/m² au Grand Sud. En théorie, le territoire désertique de l’Algérie pourrait générer à lui seul plus de 169 400 TWh, soit 5 000 fois la consommation nationale annuelle d’électricité.
Cette réalité pousse aujourd’hui l’Algérie à miser fortement sur le développement de l’énergie solaire. Si. dans son dernier bilan, le Commissariat algérien aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) a indiqué qu’à la fin de l’année 2023, la puissance totale des énergies renouvelables dans le mix énergétique algérien (hors hydroélectricité) s’élevait à 476 MW, dont 436,8 MW issus de l’énergie solaire photovoltaïque, l’objectif du Programme national des EnR est d’installer une puissance d’origine renouvelable de l’ordre de 22 000 MW à l’horizon 2030, dont près des deux tiers serait d’origine solaire (13 575 MW), pour le marché national, mais aussi potentiellement pour l’exportation.
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs projets sont en cours de réalisation, essentiellement dans le solaire. Ainsi, le projet de production de 3 200 MW d’électricité solaire a été réellement mis sur les rails avec la signature, le 14 mars 2024 à Alger, des contrats de réalisation de plusieurs centrales avec des sociétés algériennes et étrangères (principalement chinoises). Ce projet, qui semble poser les premiers jalons d’une véritable industrie autour des énergies renouvelables (le cahier de charge prévoit une clause de contenu local minimum), porte sur la réalisation d’un total de 20 centrales photovoltaïques sur plusieurs wilayas (départements) du pays. Le coût global du projet est estimé à environ 2 Mds $. Ces centrales entrent dans le cadre de la stratégie visant une production de 15 000 MW d’électricité d’origine solaire d’ici 2035.
Au-delà de l’aspect écologique et environnemental de la transition énergétique, l’enjeu pour l’Algérie est également économique. La production de 3 000 MW solaires signifie une économie considérable sur le gaz, principale énergie utilisée aujourd’hui dans les centrales électriques du pays. Selon les spécialistes, cette économie serait de l’ordre de 1,8 milliard m3 de gaz chaque année, ce qui permettrait à l’Algérie d’augmenter le volume de gaz destiné à l’exportation. Pour rappel, l’Algérie produit environ 137 m3 de gaz annuellement, dont plus de la moitié est destinée à l’exportation. Or, la hausse continuelle de la consommation intérieure limite les capacités du pays à exporter davantage de gaz. En développant le secteur des EnR, l’Algérie a tout à gagner, puisqu’elle aura plus de capacités gazières et pétrolières à l’exportation, surtout si l’objectif de 15 000 MW solaires est atteint d’ici 2035.
En lien avec le sujet des EnR, signalons qu’après les découvertes prometteuses en 2024 de gisements de lithium dans le sud du pays, ce qui pourrait faire entrer l’Algérie dans le club très fermé des pays producteurs de ce minerai rare, les autorités cherchent désormais à développer localement cette filière. Pour rappel, le lithium est un important levier de la transition énergétique puisqu’il est indispensable pour la fabrication des batteries de stockage de l’énergie électrique issue des EnR.
Un futur hub régional de l’hydrogène vert ?
L’hydrogène vert, obtenu par électrolyse de l’eau grâce à des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne, suscite un véritable engouement à l’échelle mondiale. De nombreux pays, qu’ils soient industrialisés ou en développement, cherchent à développer cette nouvelle source d’énergie. Les objectifs sont divers : aller vers la transition énergétique, renforcer la sécurité énergétique nationale, réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), se positionner sur un marché prometteur…
À l’image d’autres pays, l’Algérie, grâce à son potentiel solaire (mais aussi éolien), se penche de plus en plus sérieusement sur la production d’hydrogène vert. D’autant plus que beaucoup d’experts et d’études récentes estiment que l’Afrique du Nord devrait être, à l’horizon 2050, l’une des premières régions exportatrices d’hydrogène vert à l’échelle mondiale, et l’Europe la première zone importatrice. Selon certaines projections, les pays d’Afrique du Nord pourraient ainsi exporter jusqu’à 44 millions de tonnes d’hydrogène propre et engranger des recettes de 110 Mds $ d’ici 2050.
Afin de se positionner sur ce marché en développement, le gouvernement algérien, qui souhaite faire du pays un hub régional leader dans la production et l’exportation de cette énergie nouvelle, a présenté en 2023 une feuille de route autour de l’hydrogène et dans laquelle il a indiqué vouloir satisfaire 10 % de la demande européenne en hydrogène d’ici 2040. Dans les grandes lignes, cette fouille de route se divise en trois étapes : le démarrage via des projets pilotes (2023 à 2030), l’expansion et la création de marchés (2030 à 2040) et l’industrialisation et la compétitivité du marché (2040 à 2050).
À horizon 2040, l’Algérie prévoit ainsi de produire et d’exporter 30 à 40 TWh d’hydrogène gazeux et liquide, avec un mix à la fois composé d’hydrogène bleu (obtenu à partir du gaz naturel) et d’hydrogène vert (obtenu à partir des EnR), pour un montant prévisionnel d’investissement, sans le coût de stockage, estimé à 24,8 Mds $.
Aujourd’hui, le projet « SoutH2 Corridor » semble offrir à l’Algérie l’opportunité de se lancer pleinement dans le développement de l’hydrogène vert. Pour rappel, ce projet prévoit l’acheminement de l’hydrogène vert par hydrogénoduc en partie sous-marin sur une distance de 3 500 à 4 000 km depuis les sites de production d’Afrique du Nord vers les réseaux énergétiques européens en Italie, en Autriche et en Allemagne (près de 70 % de ce nouveau réseau devrait reposer sur la réutilisation de gazoducs existants qui seront reconvertis pour acheminer l’hydrogène). Le corridor « SoutH2 » devrait être pleinement opérationnel d’ici à 2030. Il sera capable de transporter jusqu’à quatre millions de tonnes d’hydrogène vert par an depuis les différents pays d’Afrique du Nord, couvrant 40 % de l’objectif de l’UE en matière d’importation d’hydrogène à horizon 2030.
Pour l’Algérie, ce projet représente une opportunité de diversifier ses exportations énergétiques, au-delà du gaz naturel qu’elle fournit déjà à l’Europe via les pipelines Medgaz et Transmed. La participation de l’Algérie à ce projet commence d’ailleurs à prendre forme. Ainsi, à l’occasion de la 12e édition de l’Africa & Mediterranean Energy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC) tenue à Oran (Algérie) en octobre 2024, deux mémorandums d’entente ont été signés entre Sonatrach et Sonelgaz, les deux principales entreprises publiques algériennes du secteur énergétique, et un consortium de sociétés européennes pour étudier la faisabilité de projets intégrés de production d’hydrogène vert et de dérivés destinés au marché européen. Le premier accord a été signé entre les deux sociétés algériennes et VNG (Allemagne), Società Nazionale Metanodotti et SeaCorridor, une coentreprise de Snam avec Eni (Italie) et Verbund Green Hydrogen (Autriche). Il porte sur la réalisation conjointe des études nécessaires pour évaluer la viabilité et la rentabilité d’un projet intégré qui vise à produire de l’hydrogène vert en Algérie, afin d’approvisionner le marché européen via le gazoduc « SoutH2 Corridor ». Le deuxième accord a été signé entre Sonatrach et le groupe pétrolier et gazier espagnol CEPSA pour la réalisation d’un projet d’hydrogène vert en deux phases. La première est dédiée à la réalisation d’études pour l’évaluation de la viabilité, l’opportunité et la rentabilité du projet, tandis que la seconde sera dédiée au développement du projet. Plus récemment, l’Algérie, la Tunisie, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche ont officiellement signé, le 21 janvier 2025 à Rome (Italie), une déclaration d’intention commune pour la réalisation du projet « SoutH2 Corridor ».
La concrétisation progressive de ce projet offre à l’Algérie l’opportunité de mettre en place localement les jalons d’une véritable industrie d’hydrogène vert. En effet, avec un marché en développement et une demande croissante de Europe en énergie propre, l’Algérie se trouve encouragée à se lancer dans la production de ce type d’énergie, surtout que le pays dispose de l’espace, du soleil (nécessaire pour produire l’électricité verte), du gaz, des infrastructures et des ressources humaines. Il faut ajouter à cela un autre élément déterminant qui joue en faveur de l’Algérie : le coût estimé de l’hydrogène algérien, dont le prix devrait osciller, selon la Sonatrach, entre 1,2 et 2 USD le kg alors qu’il se situe entre 5 et 6 USD en Europe. Dans une étude comparative du prix de l’hydrogène livré à l’Allemagne, réalisée par la société italienne Snam, le prix de l’hydrogène algérien est encore plus bas. En prenant en compte les coûts de production et de transport, à partir de différents pays à l’horizon 2040, le coût de l’hydrogène livré par l’Algérie à l’Allemagne est estimé à 0,98 USD/kg contre 3,25 USD pour l’Arabie saoudite, 1,71 USD pour la Russie et 1,01 USD pour l’Espagne.
Des projections séduisantes à concrétiser
Tous ces chiffres restent toutefois des projections qu’il faudra confronter à la réalité. Beaucoup estiment que les chiffres prévisionnels de production d’hydrogène vert sur le plan planétaire seraient surestimés et les coûts de production sous-estimés. À cela, il faut ajouter la difficulté de trouver, à l’heure actuelle, des financements internationaux pour réaliser les infrastructures nécessaires à la production, au stockage et au transport de l’hydrogène vert, dont le coût reste très élevé. La réalité de ces difficultés ne manque pas de poser la question de la rentabilité de l’hydrogène vert par rapport au gaz naturel, surtout pour les pays disposant d’importantes réserves gazières comme l’Algérie. Toutefois, malgré les doutes et les difficultés, le gaz naturel reste une source épuisable dont la durée de vie est limitée. Cette réalité impose à l’Algérie de s’intéresser à l’hydrogène vert et de développer à grande échelle la production des EnR qui rentrent dans la production de l’hydrogène vert.
Si le solaire semble dans ce cadre avoir la priorité des autorités, il est important de rappeler que l’Algérie fait également partie des pays disposant d’un potentiel considérable en matière d’énergie éolienne. Selon une étude de la Société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale, publiée en 2020, l’Algérie possède le plus grand potentiel éolien terrestre d’Afrique, avec environ 7 700 GW – soit plus de 11 fois la capacité éolienne installée mondialement à l’époque.
Le développement de ce secteur, en parallèle du solaire et de l’hydrogène, sans oublier les énergies fossiles, pourrait offrir à l’Algérie de nouvelles opportunités pour consolider sa place d’acteur central dans le marché énergétique mondial et faire du pays un véritable hub énergétique pour l’Afrique et l’Europe.