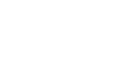Vieillissement des populations, financement des retraites, immigration, avenir du système de santé : Horizon 2035 ne compte pas revenir sur ces débats qui dominent l’actualité et le quotidien des Français mais entend explorer l’émergence de ces problématiques dans une zone où l’on pouvait penser, naïvement, qu’elles ne se poseraient pas (du moins, pas encore) : l’Amérique latine.
Or, celles-ci sont en passe d’y devenir de plus en plus cruciales, à rebours de certains a priori. Ce coup de projecteur décapant nous est fourni par Matthieu Lohse, que l’on est de nouveau heureux d’accueillir. Matthieu est un fin connaisseur des enjeux latino-américains. Pour rappel, il est diplômé de Sciences Po Strasbourg et de la Sorbonne-Nouvelle en relations internationales, a été en poste aux Etats-Unis et suit avec attention les évolutions géopolitiques, démographiques, technologiques et militaires des pays de la région.
En France, entre mai 2024 et mai 2025, le nombre de décès (651 200) a dépassé celui des naissances (650 400), marquant une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré cette inversion du solde naturel, la population française a continué de croître (+0,25 % en 2024) grâce à un solde migratoire positif, et la tendance devrait se poursuivre dans les décennies à venir. Si cette nouvelle donne démographique ne semble pas avoir eu un impact majeur sur le débat public, l’événement est important et mérite un coup de projecteur. La France n’est pas le seul pays touché par ce phénomène, que l’on retrouve dans la plupart des pays d’Europe mais aussi en Asie orientale. Mais qu’en est-il de l’Amérique latine et des Caraïbes ?
Une natalité en berne
Dans les années 1960, la région affichait des taux de fécondité supérieurs à cinq enfants par femme, une jeunesse abondante et une croissance rapide de la population. Mais en l’espace d’un demi-siècle, la révolution silencieuse de la contraception, la modernisation des sociétés et l’évolution des aspirations et des mœurs ont bouleversé ce tableau. Aujourd’hui, le continent se rapproche, voire dépasse, les niveaux de fécondité les plus bas du monde, au point de rejoindre – parfois de dépasser à la baisse – l’Europe et l’Asie de l’Est. La transition est si brutale que les conséquences sur l’économie, la politique et la société s’annoncent profondes.
Prenons quelques chiffres pour illustrer cette tendance. Le Chili, longtemps moteur économique de la région, est désormais le pays avec le taux de fécondité le plus bas des Amériques : 1,16 enfant par femme en 2023, contre 1,25 un an plus tôt. En trente ans, l’âge moyen à la maternité est passé de 27 à 30 ans, et certaines régions enregistrent même moins d’un enfant par femme. L’Uruguay, autre exemple frappant, est tombé à 1,4 enfant par femme, son plus bas niveau historique. Les Bahamas présentent également, depuis 2017, la moyenne d’1,7 enfant par femme, en dessous du seuil de remplacement. Le Costa Rica, souvent présenté comme un modèle de stabilité politique et sociale, affiche 1,3 enfant par femme, ce qui positionne également ce pays dans la catégorie « ultra-basse fécondité » selon les démographes. À ces cas emblématiques, s’ajoutent les grandes puissances régionales : le Brésil et le Mexique, respectivement à 1,6 et 1,9. Bref, tout le continent est désormais engagé dans une trajectoire de faible natalité.
Pourquoi une telle chute si rapide ? Plusieurs facteurs se conjuguent. D’abord, la maîtrise des naissances est devenue la norme. Les grossesses adolescentes, longtemps très répandues, reculent fortement : au Chili, elles ont chuté de 70 % en vingt ans. Ensuite, le report de la maternité s’est généralisé. On se marie plus tard, on étudie plus longtemps, on s’installe dans la vie professionnelle avant de songer à fonder une famille. Les femmes, mieux éduquées et davantage présentes sur le marché du travail, revendiquent aussi le droit de choisir – et parfois de ne pas avoir d’enfant du tout. Enfin, la pression économique joue un rôle déterminant : élever un enfant coûte cher, et beaucoup de jeunes couples préfèrent se limiter à un ou deux enfants, voire repousser indéfiniment ce projet.
Ce phénomène n’est pas propre à l’Amérique latine. L’Europe a franchi depuis longtemps la barre des 2,1 enfants nécessaires au renouvellement des générations : l’Union européenne est aujourd’hui autour de 1,5. Les États-Unis stagnent à 1,6, et ne maintiennent – jusqu’à présent – une croissance démographique que grâce à l’immigration. Mais ce qui distingue l’Amérique latine, c’est la vitesse de la transition. Là où l’Europe a mis près d’un siècle à descendre sous le seuil des 2, la Colombie, le Brésil, le Mexique ou le Chili ont accompli le même mouvement en trois décennies. C’est cette rapidité qui interroge et qui inquiète les démographes.
Quels effets à moyen terme ?
Concrètement, quel panorama se profile dans vingt ou vingt-cinq ans si la fécondité reste autour de 1,4 ? D’abord, un ralentissement brutal de la croissance de la population active. En Uruguay, un enfant né aujourd’hui sera un jeune adulte en 2045. S’il entre sur un marché du travail où chaque travailleur doit financer la retraite de plus en plus de personnes âgées, la pression sera considérable. Le ratio de dépendance – c’est-à-dire le nombre de personnes âgées par rapport aux actifs – augmentera rapidement. Les systèmes de retraite, déjà fragiles et moins élaborés qu’en Europe, devront alors faire face à une équation presque insoluble : moins de cotisants, plus de bénéficiaires. Les dépenses de santé suivront la même pente, car les populations vieillissantes exigent plus de soins de longue durée. On pourrait penser que moins d’enfants à charge libère des ressources pour les familles et les États. C’est vrai… mais seulement à court terme. À moyen terme, la pyramide des âges s’inverse, et l’on perd ce que les économistes appellent le « bonus démographique », cette fenêtre durant laquelle une majorité de la population est en âge de travailler et contribue à la richesse collective. Or, ce bonus se referme plus vite que prévu dans la région.
Dès lors, la question du devenir de l’État social se pose de manière cruciale. La protection sociale en Amérique latine reste fragmentée : certains pays disposent de systèmes universels relativement robustes, comme le Costa Rica ou l’Uruguay, d’autres demeurent inégalitaires et dépendants de l’emploi formel, comme le Mexique ou le Brésil. Mais partout, la tendance est la même : la dépense sociale va augmenter. Les retraites absorberont une part croissante des budgets nationaux. Les systèmes de santé, déjà fragilisés par la pandémie de Covid-19, devront se préparer à une explosion des maladies chroniques liées à l’âge : cancers, diabète, maladies neurodégénératives. Or, dans des pays où l’économie informelle représente parfois jusqu’à 40 % de l’emploi, la base de cotisation est insuffisante. Cela signifie que l’impôt général devra prendre le relais, accentuant la pression fiscale et les tensions budgétaires. La question est donc la suivante : comment maintenir la cohésion sociale dans un contexte de faible natalité, de vieillissement rapide et de budgets publics limités et d’inégalités économiques particulièrement élevées (plus de 80 % des pays de la région ont un indice de Gini supérieur à 40) ?
Face à cette perspective, un constat s’impose, à rebours des discours politiques populistes : la migration apparaît comme un levier incontournable. Déjà, les flux intracontinentaux jouent un rôle : le Venezuela a vu plusieurs millions de ses ressortissants s’installer en Colombie, au Pérou ou au Chili. Ces arrivées, souvent jeunes, ont permis de compenser partiellement le déficit de main-d’œuvre. Mais les migrations massives posent des questions d’intégration, de cohésion sociale et d’équité, y compris avec des populations de même langue, de même religion et de culture relativement similaire. Dans un Chili vieilli et peu fécond, l’appel à la migration pourrait devenir une nécessité structurelle. Comme l’explique Fernando Zegers, expert en fertilité, si aucune politique sérieuse n’est mise en place pour encourager la natalité, « le Chili devra vivre des migrants ».
Le vieillissement aura aussi des effets politiques. Les études montrent que les électeurs âgés votent plus souvent pour des partis conservateurs. Si cette tendance se confirme, faut-il s’attendre à ce que l’Amérique latine soit bientôt gouvernée uniquement par la droite ? Ce scénario n’est pas inévitable. Tout dépendra de la mobilisation des jeunes, de l’intégration politique des migrants et de la capacité des partis progressistes à répondre aux besoins des seniors sans renier leurs valeurs. Mais il est certain que la balance démographique pèsera lourd dans les urnes, avec un poids croissant de l’électorat âgé.
Le marché de l’emploi, lui, se transformera en profondeur. Moins de jeunes signifie une concurrence accrue pour certains secteurs, mais aussi une rareté qui peut tirer les salaires vers le haut. L’économie du care, des services aux personnes âgées, pourrait devenir le moteur de l’emploi. Mais attention : si l’on ne prépare pas suffisamment de travailleurs qualifiés dans ce domaine, le système de santé et de dépendance risque de s’effondrer sous la charge.
À ce stade, un détour par le Brésil et le Mexique éclaire la situation. Avec des taux de fécondité autour de 1,7 environ, les deux géants sont encore légèrement au-dessus du Chili ou de l’Uruguay, mais la trajectoire est la même. Le Mexique, en particulier, qui a longtemps été une terre d’émigration vers les États-Unis, devra sans doute compter sur l’immigration pour maintenir sa population active d’ici 2050, en provenance ; prioritairement de ses voisins méridionaux d’Amérique centrale, voire des Caraïbes (Haïti), mais aussi – potentiellement – de contrées plus lointaines. Le Brésil, quant à lui, connaît déjà un ralentissement de la croissance de sa population et anticipe un vieillissement accéléré.
L’impact du changement climatique
À ces dynamiques internes, s’ajoute une autre donnée lourde : le changement climatique. L’Amérique latine et les Caraïbes sont parmi les régions les plus exposées au dérèglement climatique. Les ouragans plus fréquents dans les Caraïbes, les sécheresses au Brésil ou en Argentine, la fonte des glaciers andins qui menace l’approvisionnement en eau de millions d’habitants : tout cela pousse déjà des milliers de personnes à migrer au Panama, au Pérou, et à travers tout le continent. Ces migrations climatiques vont s’amplifier dans les décennies à venir. Or elles s’ajouteront aux migrations « démographiques » rendues nécessaires par la faible natalité. Autrement dit, les pays devront gérer à la fois un besoin d’immigration pour compenser le vieillissement, et une pression migratoire due aux catastrophes climatiques. Comment concilier ces deux mouvements ? Comment accueillir quand on a besoin de bras, mais que l’État social est déjà sous pression ? Cette équation sera sans doute l’un des plus grands défis politiques de la région dans la seconde moitié du siècle.
Les comparaisons avec l’Europe sont instructives. Là aussi, la fécondité basse a entraîné une pression insoutenable sur les retraites, obligeant à repousser l’âge légal ou à réduire les prestations. Mais l’Europe a aussi montré qu’il est possible de stabiliser la fécondité autour de 1,7 grâce à des politiques de soutien à la parentalité : congés parentaux généreux, systèmes de garde accessibles, aides financières. L’Amérique latine n’a pas encore généralisé de telles politiques. Le Chili commence à s’y aventurer avec des mesures comme la réduction du temps de travail ou des programmes de soutien aux aidants familiaux, mais la route reste longue.
Les États-Unis offrent un autre modèle, plus dépendant de l’immigration. Le pays affiche une fécondité de 1,6, mais reste en croissance démographique grâce aux arrivées de migrants, qui assurent une partie du renouvellement générationnel. Là encore, ce choix implique des tensions sociales et politiques, comme l’illustrent les débats récurrents sur la réforme migratoire. Toutefois, avec le retour de Donald J. Trump à la Maison Blanche depuis janvier 2025 et la mise en œuvre de son programme anti-immigration, quel sera le visage de l’Amérique dans quelques années. S’il est difficile d’anticiper les impacts de ces politiques publiques à long terme, certains secteurs comme l’agriculture pâtissent déjà du manque de main d’œuvre.
Quelles perspectives alors pour l’Amérique latine et les Caraïbes ? Si rien ne change, la région pourrait entrer dès 2040 dans une phase de stagnation démographique, suivie d’un déclin. L’âge médian dépasserait alors les cinquante ans dans certains pays, se rapprochant ainsi de la situation prévalant en Europe. Les retraites deviendraient le principal poste de dépense publique, au détriment de l’éducation et de l’innovation. Mais il existe des leviers d’action. Relancer la natalité est difficile, mais pas impossible. Stabiliser autour de 1,8, par exemple, exigerait des politiques ambitieuses : conciliation entre vie professionnelle et familiale, accès facilité au logement, soutien aux jeunes couples. Miser sur une immigration ciblée, jeune et qualifiée, permettrait aussi d’équilibrer la pyramide des âges, à condition de réussir l’intégration.
À l’heure où l’extrême-droite et la mouvance populiste semble trouver des relais partout dans le monde, amplifiant les discours de haine et la xénophobie, le débat sur l’immigration doit être posé de façon claire et honnête, loin des véhémences et des surenchères électoralistes. La tâche s’annonce immense : au Chili, où la campagne présidentielle vient de débuter, l’immigration occupe une place majeure dans le débat public. Le candidat d’extrême-droite José Antonio Kast, qui occupe la première place des sondages, s’est distingué à de nombreuses reprises par des propos stigmatisants envers les migrants. Sera-t-il le prochain président du Chili ?