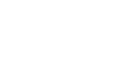Le monde de demain va continuer à reposer sur la recherche permanente de croissance économique. Mais il faudra également tenir compte, de plus en plus, d’impératifs liés au dépassement des limites planétaires et à l’avalanche de contraintes qui en découle. Les efforts pour résoudre cette quadrature du cercle vont se traduire par une exploitation toujours plus intensive (et se voulant toujours plus optimisée) des ressources tirées du sol (productions agricoles et élevage, surfaces constructibles) ; du sous-sol (minerais critiques, hydrocarbures) ; des océans (ressources halieutiques), des fonds marins et de l’ultra-profond (nodules polymétalliques et câbles sous-marins) ainsi que de l’espace aérien (aviation commerciale) et de l’orbite basse (économie spatiale). Le « système Terre » peut se découper en diverses tranches assimilables à des espaces économiques exploitables ou à rentabiliser. Dans cette logique, un nouveau champ d’intervention est en train de se développer ces dernières années : la basse altitude, dont l’intensification de l’exploitation commerciale s’annonce spectaculaire au cours de la prochaine décennie.
Le décollage d’un concept porteur
Par « basse altitude », il faut entendre l’espace aérien situé entre le sol et une altitude de 1000 mètres, soit bien en deçà de celle des couloirs aériens empruntés par l’aviation commerciale. Cette « couche » est en passe d’abriter un très large spectre d’activités qu’elles soient de nature économique (tant de services qu’industrielles) ou relevant de services publics, exécutées par une vaste gamme d’engins aériens. Modernité oblige, ceux-ci, pour la plupart, sont désormais automatisés ou pilotés à distance et fonctionnent de plus en plus à l’électricité : drones (unmanned aeriaI vehicIe/ UAV), engins à décollage court et vertical (vertical or short take-off and landing / V/STOL), hélicoptères et avions légers, taxis ou véhicules volants, sondes et ballons captifs. Des aéronefs de toute taille et de toute nature, en charge d’assurer « à basse altitude » des prestations relatives au transport de passagers, à l’acheminement de colis ou de charges légères, à l’épandage au-dessus des terres agricoles, au recueil de données en temps réel ou à des missions d’intérêt général. Ces dernières peuvent englober des évacuations médicales, des opérations de sauvetage ou de lutte contre les incendies, le contrôle et l’entretien d’infrastructures critiques (lignes à haute tension, barrages, ponts, tunnels) ou encore la surveillance et la fourniture d’informations aux forces de l’ordre en situation de crise ou d’urgence.
La densification de cette activité aérienne « de proximité » devient de plus en plus visible et s’avère en passe de révolutionner des pans entiers de l’activité économique (transport, logistique, maintenance industrielle, agriculture, animation et spectacles aériens, les ballets nocturnes lumineux de drones se substituant de plus en plus aux feux d’artifice d’antan), mais aussi nombre de fonctions régaliennes (gestion de catastrophes, naturelles ou industrielles, contrôle des foules, lutte contre l’insécurité). De quoi modifier dans une large mesure bien des aspects de la vie quotidienne, mais aussi bouleverser l’organisation et le fonctionnement de certains secteurs d’activités.
L’impact s’annonce également significatif sur l’architecture citadine et les perspectives d’évolution de l’urbanisme (construction de vertiports, de parkings intelligents et de bornes de recharge pour aéronefs ; élaboration de couloirs urbains préétablis de circulation aérienne en basse altitude ; centres de contrôle du trafic aérien basse altitude gérés par du personnel spécifiquement formé à ces tâches).
Les grandes agglomérations vont devoir prendre en compte, à l’avenir, l’exploitation de cette nouvelle dimension (au même titre que les réseaux souterrains) et les nombreuses applications qui y sont liées : mobilité urbaine, en particulier au profit d’une petite frange de la population (plutôt aisée) ; floraison de nouvelles activités économiques et de services ou transformation d’anciennes ; optimisation de l’espace public ; contrôle des nuisances ; évaluation et suivi des risques et menaces pesant sur ces activités aériennes et leurs interactions avec le « métabolisme » des smart cities de demain.
L’économie de basse altitude (low-altitude economy / LAE) ne se limite plus à une activité vaguement récréative pour geeks et fanas aéro. Les opportunités économiques apparaissent considérables, en offrant des solutions potentiellement efficaces à divers défis que devront surmonter les populations citadines modernes, comme la congestion urbaine ou la réaction rapide à des situations d’urgence. Une récente étude de PWC évaluait l’impact économique à l’échelle mondiale de l’usage de drones civils à 127 Mds$ en 2026. Une autre, rédigée par Morgan Stanley, estimait le marché de la seule mobilité aérienne urbaine (navettes aériennes et taxis volants) à 1 500 Mds$ à l’horizon 2040 !
Assurer la gestion optimisée et sécurisée du trafic aérien en environnement urbain à forte densité (tant au regard du bâti que de la population) va nécessiter la mise en œuvre d’innovations technologiques (en matière de navigation et de géolocalisation en temps réel, d’évitement d’obstacles, de connectivité 5 et 6 G, de cartographie d’espaces et de situations mouvantes) et d’intégration industrielle poussées (batteries électriques, systèmes de communication, matériaux intelligents, résistants et légers comme les composites thermoplastiques ; technologie LiDAR) ainsi que la production de nouvelles normes sociales (imposition de réglementations adaptées, émergence de nouveaux comportements, usage privilégié au service de populations aisées, acceptation ou rejet par la population « lambda » des contraintes visuelles ou sonores liées à ce trafic aérien passant au-dessus de sa tête ou sous ses fenêtres…).
Une évolution multifacette d’une aussi forte magnitude pour l’environnement urbain ne sera envisageable qu’avec l’assistance de l’IA et le recours à des réseaux intelligents, conçus pour aider à gérer au mieux les flots de données générés en permanence par ce nouveau contexte. Il va en résulter une convergence entre le secteur aéronautique, celui de l’automobile, de la métallurgie et des matériaux intelligents, des batteries électriques, de l’électronique embarquée, de l’IA, du BTP et de l’urbanisme, sans oublier une petite pointe d’expertise en capital-risque et en droit. Le tout vise, ni plus ni moins, à concrétiser dans la vie de tous les jours – à l’horizon 2030 – certaines fulgurances visuelles, jusqu’alors purement fictionnelles, entrevues dans des films comme Retour vers le futur, Blade Runner ou Le Cinquième Élément, références qui ne manqueront pas de parler aux honorables lecteurs ayant en mémoire quelques scènes culte de ces « incontournables » du Septième Art !
La Chine en pole position
Cette évocation de l’horizon 2030 s’applique surtout à l’Occident car, en Chine, ce futur est déjà là et ne cesse de se consolider, semaine après semaine, voire jour après jour.
Dès le début de la décennie 2020, la CAAC (Civil Aviation Administration of China), l’administration chinoise en charge du secteur aérien, a lancé des expérimentations dans une douzaine de zones à travers le pays pour favoriser le développement de vecteurs autonomes ou pilotés à distance, mais aussi d’applications reposant sur ces vecteurs aériens, et a ainsi posé les bases de ce qui est désormais conceptualisé sous la dénomination « économie de basse altitude ». Au vu des premiers résultats encourageants, l’expérimentation technique bascule rapidement vers le registre administratif et politique. En février 2021, le concept d’ « économie de basse altitude » est retenu dans les travaux préparatoires du Plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine, adopté le 11 mars 2021 par le Congrès national du peuple. Couvrant la période 2021-2025, ce document fixe les priorités stratégiques du pays et définit les objectifs de développement durable tout en intégrant des innovations technologiques. L’économie de basse altitude constitue un des axes d’effort privilégiés. La séquence expérimentale se poursuit en 2022 /2023 et s’étend à travers le pays. Un point de bascule intervient à l’occasion de la Conférence annuelle du travail économique central (Central Economic Work Conference) de décembre 2023, destinée à établir les priorités économiques pour l’année à venir : le développement de l’économie de basse altitude est retenu parmi les secteurs prioritaires pour 2024, au même titre que la bio-fabrication (bio-manufacturing), l’économie spatiale commerciale, les réseaux intelligents, les nouveaux matériaux ou les technologies quantiques.
Dès lors, toute la base technologique et industrielle du pays est fortement invitée à se lancer dans l’aventure de l’économie de basse altitude tandis que l’administration est appelée à concevoir une réglementation adaptée. Les autorités locales sont également incitées à s’engager dans cette voie, en multipliant subventions et facilités pour les innovateurs technologiques, les industriels et les opérateurs économiques tout en œuvrant au développement d’infrastructures adaptées. Les choses vont vite : en 2023, le parc aérien chinois comptait plus d’un million de drones enregistrés auprès des autorités. Le seuil du million et demi devrait être atteint en 2025. Plus de 20 millions d’heures de vol avaient été décomptées par la CAAC en 2023. En octobre 2023, la CAAC a délivré la première certification à un engin eVTOL (engin électrique à décollage vertical) , l’EH216-S, conçu par la firme EHang, autorisant cet appareil biplace à effectuer des vols commerciaux, sans pilote – une première mondiale. Et, en janvier 2024, cette même administration a édicté un règlement provisoire sur la gestion des vols d’aéronefs sans pilote (Interim Regulations on the Management of Unmanned Aircraft Flights) afin d’offrir un cadre réglementaire et législatif au développement ordonné du secteur.
Pas moins de 16 provinces (sur 34) ont repris dans leur planification locale ce concept d’économie de basse altitude. Mais trois pôles provinciales se détachent rapidement par l’ampleur des efforts et des investissements consentis (et des résultats obtenus).
- La province du Guangdong entend devenir le pôle mondial dominant de l’économie de basse altitude et a lancé un premier plan de développement sur la période 2024-2026, avec comme objectif de générer plus de 40 Mds$ d’activités dans ce secteur en 2026. Ce plan repose sur la coordination des efforts de trois grandes métropoles-clés (Canton / Guangzhou, Shenzhen et Zhuhai), tout en misant sur le partenariat avec Hong Kong et Macao au sein de la Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Ce programmeprend en compte l’essor de l’activité « basse altitude » dans son ensemble, qu’il s’agisse de la gestion de l’espace aérien provincial et métropolitain, du développement des infrastructures, de l’expansion des applications urbaines, du soutien à l’innovation industrielle, sans oublier la création de parcs industriels spécifiquement dédiés. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Outre DJI, le leader mondial du drone (placé sous sanctions américaines pour avoir fourni des composants à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine), deux autres principaux fabricants de véhicules volants sont implantés dans la province : EHang, spécialisé dans les eVTOL, etXpeng Aeroht, la branche voiture volante du constructeur automobile Xpeng Motors. Cet écosystème techno-industriel en pleine expansion a incité Airbus Helicopters à implanter le nouveau siège de sa filiale chinoise à Hengqin, en plein cœur de la Guangdong-Macao In-depth Cooperation Zone.
Pour doper l’activité, la municipalité de Guangzhou a adopté, en juillet 2024, un document intitulé « Several Measures of Guangzhou Municipality to Drive the High-Quality Development of Low-Altitude Economy », comprenant 20 mesures destinées à favoriser l’économie de basse altitude, dont l’installation de 100 points de décollage / atterrissage intra-urbains d’ici 2027, la mise en place d’un fonds de financement pour soutenir les opérateurs économiques ou encore la création d’une route touristique aérienne sans pilote permettant de visiter une dizaine de hauts lieux de l’agglomération « à basse altitude » échelonnés le long d’itinéraires prédéfinis.
Mais le gros de l’activité se situe dans la zone économique spéciale de Shenzhen, qui abrite plus de 1 500 entreprises opérant dans le secteur de la « basse altitude », lesquelles ont généré un chiffre d’affaires de plus de 10 Mds$ en 2022. Shenzhen en escompte 1 700 en 2025 pour un chiffre d’affaires dépassant les 14 Mds$. Les autorités locales ont édicté en 2024 un cadre législatif et réglementaire propre à la métropole (Shenzhen Special Economic Zone Low-Altitude Economic Industry Promotion Ordinances),inspiré de la législation nationale mais adapté au contexte provincial et à ses besoins spécifiques.Shenzhen a déjà construit plus de 480 vertiports et en vise 1 200 en 2026 afin d’accompagner la densification attendue du trafic. Zhuhai entend également devenir au plus vite une smart sky city et a adopté toute une série de mesures ciblées pour encourager l’essor de l’économie de basse altitude.
- Shanghai s’est également engagée dans la compétition, en publiant à la mi-août 2024 un plan d’action pour le développement économique de la basse altitude qui s’étend sur la période 2024-2027. Les autorités locales entendent faire de la métropole une Sky city de taille mondiale et générer plus de 6,5 Mds$ dans ce secteur en 2027, en bâtissant un système industriel complet (dont le champion technologique local est Volant AeroTech) et en diversifiant les applications commerciales, principalement dans la logistique, l’assistance aux secours et aux forces de l’ordre mais aussi le tourisme. Le 20 décembre 2024, les autorités ont lancé laShanghai Low-Altitude Economy Industry Development Co., Ltd., dotée d’un capital de 900 millions de yuans. Cette nouvelle entreprise comprend parmi ses actionnaires plusieurs firmes publiques de la métropole telles que Shanghai Airport Group, Shanghai Airport Investment Co., Ltd, Shanghai Urban Construction, ou encore Shanghai Information Industry Group.
- Un autre protagoniste majeur de cette quête du ciel à portée de main est la province du Hebei et la métropole régionale de Xiong’an. Sur le modèle du Guangdong, une douzaine de mesures incitatives ont été adoptées à l’été 2024 dans le but de stimuler l’activité basse altitude et d’attirer des opérateurs économiques (primes d’installation, subventions). Pour se démarquer de ses rivaux, la province mise sur la formation et cherche à attirer des profils prometteurs soucieux d’acquérir des savoir-faire recherchés et occuper des postes de haut niveau dans le secteur (Chief Scientist; Chief Technology Officer; Chief Operating Officer; Chief Architect), et de viser les rémunérations à la hauteur de ces responsabilités.
- D’autres provinces sont engagées dans cette course à la performance et aux talents comme le Sichuan, où Chengdu tente de se faire une place sur la scène nationale, mais aussi l’Anhui, le Jiangxi et la province du Hainan.
Au total, une étude de CCID Consulting (un think tank dépendant du ministère chinois de l’Industrie, décomptait), en février 2024, 57 000 entreprises chinoises engagées, d’une manière ou d’une autre, dans le secteur de l’économie de basse altitude, lequel connait chaque année, depuis le début de la décennie 2000, une croissance à deux chiffres. La CAAC projetait un chiffre d’affaires autour de 1 500 milliards de yuans en 2025 (soit l’équivalent d’un peu plus de 205 Mds$ en ce début d’avril 2025) et tablait sur 3 500 milliards de yuans à l’horizon 2035. D’autres sources fournissent des chiffres moins spectaculaires (« seulement » 670 milliards de yuans, soit 93 Mds$ en 2024 selon CCID).
Il convient effectivement de garder à l’esprit qu’au-delà des annonces mirifiques et de l’enthousiasme légitime devant tout nouveau démonstrateur ou expérimentation d’usage, le business model du secteur demeure encore largement immature. De nombreuses applications auront beaucoup de mal à s’imposer et à devenir rentables et un assainissement « sanglant » du secteur est à attendre au cours des prochaines années, au terme duquel seules quelques dizaines d’entreprises aux reins suffisamment solides auront survécu, selon une dynamique déjà observée dans le secteur des véhicules électriques. Nul doute que les « survivantes » auront acquis une redoutable efficacité pour partir à la conquête du monde.
Le reste du monde : des start-ups en stand by
L’engouement spectaculaire de la Chine pour l’économie de basse altitude tarde à se manifester hors de l’Empire du Milieu, même si de grands hubs commerciaux comme Dubaï ou Singapour se montrent très intéressés par les applications qui en découlent. Les initiatives sont, pour l’heure, plus timorées en Occident, entre lourdeur administrative, réticence sociétale, faibles investissements, autres priorités technologiques et crainte de cybermenaces paralysant l’activité. De nombreuses start-ups occidentales aspirent néanmoins à se lancer dans la voiture volante ou l’e-V/STOL, au-delà des firmes travaillant sur des drones à finalité militaire. Mais le concept d’économie de basse altitude peine à percer auprès des élites dirigeants politiques, administratives ou financières occidentales.
- Les États-Unis ont longtemps été considérés comme le « paradis pour l’aviation légère » et précurseurs en matière de drones, via de nombreux programmes généreusement financés par le Pentagone (ex : Projet « Agility Prime » de l’US Air Force) ou la NASA (cf. projet « Advanced Air Mobility » / AAM). Ils semblent néanmoins avoir été dépassés par la Chine, en dépit de ce riche patrimoine aéronautique et de nombreux atouts en matière d’innovation, de financement, de technologies et de savoir-faire industriels. Plusieurs start-ups américaines sont dans les starting-blocks pour se lancer dans l’aventure des e-V/STOL, comme les californiennes Archer Aviation, Joby ou encore Zeva Aero en Floride, qui explore l’option d’une machine volante individuelle. Joby, en partenariat avec Delta Airlines, entend prochainement lancer un service de robot-taxi aérien reliant le centre de New York aux aéroports JFK et LaGuardia. Le prix du trajet pour client fortuné pressé devrait être similaire à celui d’une course en formule premium Uber Black, avec un gain de temps très conséquent. Los Angeles et Orlando, en Floride, projettent la mise en place de services similaires, nécessitant la construction d’un réseau de vertiports et l’établissement d’itinéraires préétablis. Pour sa part, l’incontournable Elon Musk soutient, via SpaceX, un projet de véhicule volant élaboré par la firme californienne Alef Aeronautics qui revendiquait, en septembre 2024, quelque 3 200 précommandes et des partenariats techniques et industriels avec divers grands acteurs du secteur aéronautique. Des essais en vol en milieu urbain de son Model A ont débuté en février 2025, et le démarrage de la production en série est attendue d’ici la fin 2025. Mais le niveau de maturité de ce projet semble, actuellement, très en deçà de celui de certains de ses concurrents chinois. Par ailleurs, le pays abrite de nombreuses expérimentations de livraisons de charges légères par drones, pas toujours des plus concluantes. Cependant, ce marché est jugé d’avenir et mobilise à la fois des spécialistes du transport logistique, soucieux de s’adapter à la technologie (DHL, UPS, FedEx), ainsi que des filiales des GAFAM désireux d’élargir les applications quotidiennes de leur savoir-faire (Amazon Prime Air et Wing Aviation, filiale d’Alphabet/ Google).
- En Europe, l’approche est encore plus timide malgré l’existence d’une puissante industrie aéronautique qui a cependant raté le virage technologique du drone, au début du XXIe siècle, et souffre pour rattraper son retard. Le pays le plus en pointe apparaît être l’Allemagne avec des firmes comme Lilium et Volocopter (on rajoutera à ce tropisme germanique l’autrichien Schiebel, le fabricant de la famille de drones d’observation Campcoter). La France, en dépit de son savoir-faire aéronautique, est étonnamment à la traîne en la matière, même si de gros efforts sont engagés pour combler le retard accumulé. Les JO de Paris auraient pu constituer une fenêtre de visibilité exceptionnelle pour populariser certaines solutions de mobilité urbaine aérienne, mais la tentative, impliquant l’allemand Volocopter (avec son engin Velocity), Aéroports de Paris (Groupe ADP) et la RATP, a échoué, entre problèmes techniques mal maîtrisés, rigueur administrative et critiques abondantes contre une solution de mobilité coûteuse et réservée à quelques VIP. Par ailleurs, s, afin de favoriser l’essor de l’économie de basse altitude, l’Union européenne, via l’EASA, a lancé l’U-Space initiative destinée à favoriser l’intégration des drones dans la gestion de l’espace aérien.
Le Vieux Continent joue néanmoins un rôle considérable dans l’utilisation de la « basse altitude », mais dans un registre tout autre et très particulier : il abrite la première guerre menée intensivement « en basse altitude ». Le conflit en Ukraine se caractérise en effet par l’usage frénétique, de drones armés ou d’observation et de reconnaissance, les deux belligérants multipliant à un rythme échevelé les innovations techniques et tactiques au fil des mois. Qui n’a pas visionné au moins une fois les images prises d’un drone survolant le terrain d’opération, repérant une cible et fondant dessus pour sa charge létale contre le véhicule ou le fantassin visé ? Ce recours massif et précis des drones, capables d’agir seuls ou en essaim (via le recours à l’IA), a modifié de manière significative le déroulement des opérations. Le taux d’efficacité des frappes par drones a prodigieusement progressé au fil des combats. Le recours intensif à ces engins conduit à repenser l’usage et la finalité de nombreux systèmes d’armes au nom d’un nouveau rapport coût/efficacité, des engins customisés pour quelques centaines de $ à partir de plates-formes civiles produites en grand nombre étant en mesure de détruire avec une grande fiabilité des équipements sophistiqués dont la valeur se chiffre en centaines de milliers, voire millions, de $ ou d’€. Soit une transformation radicale de l’économie de guerre et des moyens qu’aucun Livre blanc sur la défense rédigé ces dernières années n’avait anticipé avant le démarrage de ce conflit.
Nul doute, une fois le conflit achevé, que l’Ukraine disposera de capacités technologiques et industrielles surdimensionnées qu’il sera aisé de reconvertir au service de « l’économie de basse altitude » à l’échelle mondiale. Dans la course à l’innovation, le Vieux Continent n’est pas tout à fait hors-jeu !