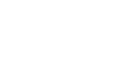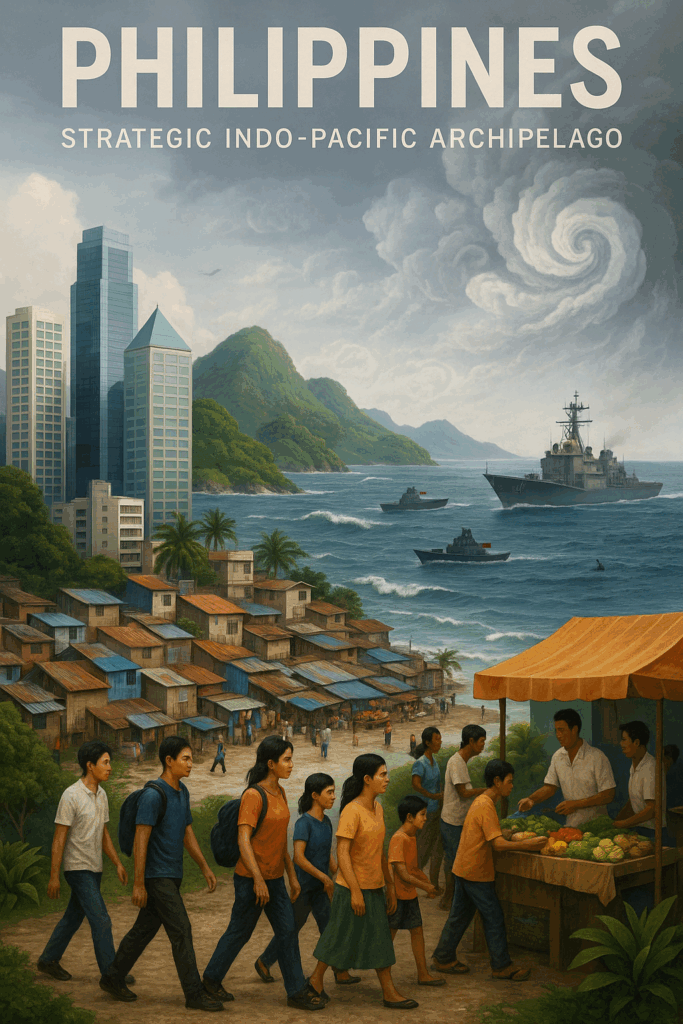Si la zone Indo-Pacifique fait très régulièrement la Une de l’actualité (tensions sino-américaines, menaces sur Taïwan, péninsule coréenne, partenariat AUKUS…), il est un acteur de cette région particulièrement mal connu en France : les Philippines. Notre vision de cet immense Etat archipélagique se limite trop souvent à celle du pays d’origine du lumpenprolétariat, sous-payé et taillable et corvéable à merci qui permet au transport maritime international de fonctionner au moindre coût ou de celui des nombreuses bonnes et dames à tout faire, parfaitement anglophones, qui s’occupent de nos chères petites têtes blondes à la sortie des écoles dans certains quartiers huppés. C’est une vision très limitée de ce pays d’au moins 115 millions d’habitants, parfaitement intégré au sein de l’économie mondialisée et qui affiche une croissance soutenue. Pour cela, Manille a misé sur le secteur tertiaire et sur une main d’œuvre abondante et mobile, qui ne rechigne pas à s’exporter sur tous les continents (et tous les océans) dans l’espoir de trouver des emplois mieux rémunérés qu’au pays. Les Philippines disposent également d’un potentiel maritime et minier insuffisamment exploité jusqu’à présent. Le pays s’avère également confronté aux effets du changement climatique et occupe une position stratégique de toute première importance dans le Pacifique Ouest, en plein cœur de la rivalité sino-américaine. Ce sont tous ces aspects qu’Horizon 2035 vous propose d’explorer dans cet article. Notre guide sera Tom Salmon, diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l’Université Panthéon-Sorbonne en relations internationales et commerce international, actuellement basé à Paris après plusieurs affectations en Asie du Sud-Est, et tout particulièrement aux Philippines. Merci à lui de nous faire partager sa connaissance de ce pays mal connu !
Trop peu connues du grand public en France, où elles sont surtout évoquées dans les médias lors de catastrophes naturelles ou plus récemment en lien avec les tensions en mer de Chine méridionale, les Philippines sont le 3ème plus grand pays archipélagique du monde (englobant quelques 7000 îles) et disposent d’une économie dynamique ayant crû de 5,3% en moyenne sur 15 ans. Son PIB s’est élevé à 462 milliards de dollars en 2024 (équivalent pratiquement à celui du Vietnam ou, dans une autre mesure, à celui du Danemark, 10 fois moins peuplé). Selon le FMI, la croissance annuelle moyenne devrait s’y maintenir à 6% jusqu’en 2030. Contrairement aux « tigres » asiatiques, le développement de l’archipel repose sur la consommation interne (86,9% du PIB) et une tertiarisation précoce (63,2%), liée aux choix des conglomérats locaux, qui ont faiblement investi dans l’industrie pour se spécialiser dans la distribution, l’immobilier et les services publics. Le principal atout du pays est sa population jeune, culturellement américanisée, mobile et prête à s’exporter.
Pour tirer pleinement parti du dividende démographique, le gouvernement philippin devra relever le défi du développement des compétences, dans un archipel confronté à une crise éducative majeure (77e sur 81 au classement PISA 2022). Bien que fragilisées par le changement climatique et un déficit commercial structurel affectant leur souveraineté alimentaire et énergétique, les Philippines disposent d’atouts pour développer leurs industries exportatrices, notamment dans les secteurs minier et électronique. Situées entre le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale, elles devront aussi composer avec les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine pour tirer parti de leur position stratégique.
Une population jeune tirant profit de l’économie mondialisée
Depuis 1987, la population philippine a doublé pour atteindre 115,8 millions d’habitants, faisant de l’archipel le 14ᵉ pays le plus peuplé. Malgré un ralentissement de la croissance démographique, elle a encore crû de 0,8% en 2024 et devrait culminer à 135 millions en 2057 selon l’ONU. Avec un âge médian de 25,7 ans et une forte maîtrise de l’anglais, la population est connectée et adaptée à l’économie mondialisée, ce qui lui donne un avantage
comparatif dans les services et notamment dans le secteur de l’externalisation des processus métiers (Business Process Outsourcing / BPM). La tertiarisation précoce a accentué les inégalités entre zones urbaines et rurales, ainsi qu’entre travailleurs qualifiés et non qualifiés, malgré une croissance soutenue (le coefficient Gini est l’un des plus élevés de la région avec la Malaisie).
Secteur en plein essor, le BPM générait 38 milliards de dollars à l’export en 2024 (8,2% du PIB) et employait 1,8 million de personnes, contribuant à l’émergence d’une classe moyenne bien que limitée. Les Philippines ont dépassé l’Inde dans les secteurs des services vocaux et de l’assistance à la clientèle, en profitant de l’accent neutre des opérateurs locaux et de leur proximité culturelle avec les pays anglo-saxons. Si ces services représentent encore 80% du marché, l’industrie évolue vers des segments à plus forte valeur ajoutée nécessitant des compétences techniques (Knowledge Process Outsourcing / KPO), dans la finance, la santé, le juridique et l’informatique.
Le secteur BPM philippin fait face à plusieurs défis, notamment le manque d’infrastructures numériques et la montée de l’intelligence artificielle. Les investissements dans les data centers, les câbles sous-marins et la 5G devraient néanmoins soutenir la transition vers le KPO, moins exposé à l’automatisation (services digitaux financiers et de santé, commerce en ligne). Cette montée en gamme entraîne toutefois un risque accru de fuite des cerveaux, les compétences techniques nécessaires à ces activités étant facilement transférables vers des marchés à plus hauts revenus, alors que le salaire moyen dans le BPM reste modeste aux Philippines (790 dollars par mois).
La diaspora philippine compte 10,8 millions de personnes, soit 9% de la population, dont 47% vivent aux États-Unis. Parmi eux, 2,2 millions sont des Overseas Filipino Workers (OFW), envoyés à l’étranger via des contrats encadrés. Ce phénomène, a été encouragé par les autorités de Manille dès la période de la Loi Martiale (1972–1986) pour compenser le déficit du compte courant et l’insuffisance du marché du travail local face à la croissance
démographique. En 2024, les transferts de fonds ont atteint 34,5 milliards de dollars, soit 6,5% du PIB, plaçant les Philippines au 3ᵉ rang mondial derrière le Mexique et l’Inde. Les principaux pays d’accueil sont les États du Golfe, Hong Kong et les États-Unis, qui génèrent à eux seuls 40% des transferts. Par ailleurs, les marins philippins, qui représentent 25 à 30% des effectifs de la marine marchande mondiale, sont à l’origine de 20,1% des
transferts de fonds. Les politiques anti-immigration américaines, au même titre que les droits de douanes, suscitent donc de fortes inquiétudes à Manille.
L’ampleur de ces transferts financiers a profondément modifié les équilibres macroéconomiques du pays : ces envois de devises soutiennent la consommation des ménages (76,1% du PIB), mais alimentent aussi un déficit commercial élevé (61,9 milliards de dollars en 2024). Cette manne financière provoque un effet proche du « syndrome hollandais » lié à l’exploitation des ressources naturelles, car il contribue à l’appréciation du
peso et freine le développement de l’industrie domestique (faible compétitivité et attractivité aux investissement étrangers).
Des fragilités structurelles liées à un déficit commercial chronique
Les perspectives de l’économie philippine sont obérées par un déficit commercial structurel, révélateur de la vulnérabilité de l’archipel en matière de souveraineté énergétique et alimentaire. Le secteur énergétique dépend fortement des importations de combustibles fossiles, malgré l’exploitation de l’unique champ gazier de Malampaya (1,2 GW), dont les réserves s’amenuisent. En 2024, le déficit commercial énergétique atteignait 19,3 milliards de dollars (dont 75% de pétrole et 14% de charbon importé de l’Indonésie voisine). Le déficit commercial agroalimentaire s’élevait à 13 milliards (dont 2,5 milliards pour le riz et 2 milliards pour le blé et la viande), malgré des excédents en fruits tropicaux (bananes, noix de coco, mangues). Il est peu probable que des améliorations significatives surviennent dans ces deux registres au cours de la prochaine décennie.
L’industrie électronique constitue un levier potentiel pour réduire le déficit commercial si elle parvient à maîtriser sa montée en gamme. En 2024, les exportations de machines et équipements électriques représentaient 36,7 milliards de dollars, soit 50% des exportations totales, dont 22,6 milliards de circuits intégrés. Toutefois, le secteur reste vulnérable à l’affaiblissement de la demande mondiale et aux perturbations des chaînes de valeur (les exportations ont chuté de 9,5% en valeur en 2024), alors des recompositions massives de ces chaînes se profilent dans le contexte du conflit techno-commercial entre États-Unis et Chine.
L’industrie locale reste encore centrée sur des activités à faible ou moyenne valeur ajoutée (assemblage, test, conditionnement), avec une part importante de réexportation (l’excédent commercial en circuits intégrés n’atteint que 9,5 milliards de dollars). La montée en gamme est freinée par la concurrence régionale, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et le coût élevé de l’électricité, l’un des plus chers d’Asie. Ces difficultés devront donc être surmontées à moyen-long terme pour réussir une montée en gamme et capter la valeur ajoutée, ce qui va nécessiter une forte injection de capitaux privés en R&D afin de développer les activités de conception de circuits intégrés et la production de wafers nécessaires aux semi-conducteurs.
Le développement du secteur minier constitue une autre piste de développement. Les Philippines disposent de la 6ᵉ réserve mondiale de nickel (4 800 Mt) et la 5ᵉ de cobalt (260 Mt), deux minerais cruciaux pour la transformation énergétique des prochaines décennies. Mais en 2024, le secteur ne représentait néanmoins que 0,68% du PIB et 10,1% des exportations. L’or constitue la principale ressource exploitée (2,2 milliards de dollars), loin devant le nickel (989 millions), le sulfure de nickel et de cobalt (652 millions) et le cuivre (475 millions).
Si le cuivre bénéficie d’une industrie locale intégrée (1,8 milliards de dollars à l’export en 2024), le nickel est principalement exporté sous forme de minerai ou de concentrés, dont les Philippines sont le 1 er exportateur mondial : 1 milliard de dollar en 2024, dont 77,4% était exporté vers la Chine pour approvisionner l’industrie de l’acier inoxydable. L’exploitation du nickel se heurte à toute une série de difficultés. Nécessaire aux technologies critiques telles que les batteries, l’aéronautique et le spatial, la transformation du nickel extrait dans l’archipel – sous sa forme latéritique – engendre des coûts élevés et reste inexistante à l’exception des activités de l’entreprise japonaise Sumitomo Metal Mining. S’il existe des tentations au sein des milieux politiques philippins d’interdire les exportations de minerai brut sur le modèle indonésien, ces aspirations se heurtent à l’opposition des sociétés minières locales. La Chambre des mines des Philippines juge en effet peu crédible le développement d’une industrie de la transformation du nickel, raison d’un coût de l’énergie trop élevé et de chaînes logistiques fragiles et peu compétitives.
Malgré ces obstacles, le contexte politique est favorable au développement de l’activité minière dans l’archipel. Sous Rodrigo Duterte (2016–2022), le gouvernement avait déjà opéré un revirement favorable pour tirer parti de la demande croissante en métaux. Il avait ainsi levé à partir de 2021 les moratoires sur les licences d’exploitation et les mines de métaux à ciel ouvert. Depuis 2022, le président Ferdinand Marcos Jr apporte un soutien
explicite au développement du secteur, dans lequel sa famille maternelle – les Romualdez – dispose d’intérêts personnels via la société Benguet Corporation (exploration et exploitation minière). Par ailleurs, la réforme du régime fiscal applicable à l’industrie minière de septembre 2025 témoigne de la volonté politique de tirer profit de la manne que représente le sous-sol philippin. Selon le ministre des Finances Ralph Recto, cette réforme
devrait générer 438 millions de dollars de recettes annuelles d’ici 2028.
Un pays vulnérable aux changements climatiques
Les Philippines figurent parmi les pays les plus exposés aux événements climatiques extrêmes et au dépassement des limites planétaires. Le réchauffement devrait entraîner sécheresses accrues, inondations dévastatrices, montée des eaux et baisse des rendements agricoles, notamment en riz. Selon le GIEC, la température moyenne pourrait augmenter de 1 à 2°C d’ici 2100, et s’accompagner d’une intensification des précipitations
et des typhons. Les ressources halieutiques devraient chuter de 50% d’ici 2051–2060 par rapport au niveau de 2001-2010. La Banque mondiale estime le coût d’adaptation à 0,7% du PIB par an, avec des mesures principalement orientées vers l’agriculture, l’eau et la résistance des infrastructures aux typhons (qui causent des pertes annuelles équivalentes à 1,2% du PIB).
Malgré un fort potentiel hydraulique et géothermique, les Philippines ont dû accroître leur production électrique à partir de combustibles fossiles pour répondre à la demande, multipliée par 2,2 en 20 ans. En 2024, les énergies renouvelables ne représentaient plus que 22,2% du mix électrique (dont 38% de géothermie et 29% d’hydraulique), contre 32% en 2005, tandis que le charbon est passé de 27% à 63%. Pour réduire cette dépendance aux énergies fossiles, le gouvernement a pleinement ouvert le secteur des renouvelables (hors hydraulique) aux capitaux étrangers en 2022, bien que certaines limitations demeurent sur le foncier pour les projets onshores. Selon l’AIE, les investissements espérés devraient permettre une légère hausse des renouvelables jusqu’à 24% du mix d’ici 2027, tirée par une forte croissance annuelle moyenne du solaire photovoltaïque (+29%) et de
l’éolien (+24%). Le potentiel en éolien offshore est estimé à 178 GW, avec déjà 30 projets attribués (pour une capacité installée potentielle de 20GW). Pour diversifier son mix, le pays prévoit aussi le lancement d’un programme nucléaire civil basé sur la technologie des smart modular reactors (SMR), avec une mise en service prévue à partir de 2032 (1,2 GW).
Un contexte géopolitique incertain
A l’instar de ses voisins regroupés au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), les Philippines doivent naviguer dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis. L’originalité des Philippines réside toutefois dans sa proximité culturelle et institutionnelle avec les États-Unis et ses relations économiques anciennes forgées durant la période coloniale. Cela se traduit par une coopération militaire étroite avec Washington, encadrée par un traité de défense mutuelle signé en 1951, mais que les États-Unis interprètent comme non applicable à la zone économique exclusive (ZEE) philippine en mer de Chine méridionale.
Dépendantes économiquement de la Chine (déficit commercial de 25,1 milliards de dollars en 2024), les Philippines sont engagées dans un contentieux territorial en mer de Chine méridionale avec leur géant voisin. Durant la présidence Duterte (2016–2022), Manille avait adopté une posture conciliante avec Pékin en mettant de côté ce différend territorial – malgré une décision de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye favorable à ses revendications en 2016 – afin d’attirer des capitaux chinois. Les résultats de cette politique sont néanmoins restés limités, malgré des investissements dans les services financiers (prise de participations du chinois Ant Financial dans la société Mynt à l’origine du très populaire service de paiement mobile GCash en 2017) et les télécommunications (création de l’opérateur DITO par China Telecom en partenariat avec le philippin Udenna Corporation en 2018). Par ailleurs, les promesses chinoises de financement par l’aide publique au développement de grands projets ferroviaires (Mindanao Railway, PNR South Long-Haul, Subic-Clark Railway) ne se sont pas concrétisées. Dans ce contexte, Duterte a opéré un réajustement de sa politique à l’égard de la Chine. Ce virage a été poursuivi à partir de 2022 sous la présidence de Ferdinand Marcos Jr, se traduisant par une politique de renforcement des liens avec l’allié américain, et une volonté de protéger les secteurs stratégiques de l’influence chinoises (notamment dans les télécommunications) sur fond de multiplication des incidents impliquants navires chinois et philippins (harcèlement, collisions, usages de canons à eau par la Chine). Cette situation impacte directement le développement économique des Philippines, en réduisant leur accès aux ressources halieutiques et gazière localisées au sein de leur ZEE.
Sous l’administration Marcos Jr, les liens militaires avec les États-Unis ont été renforcés. Cette coopération s’illustre notamment par la tenue de l’exercice annuel Balikatan, qui a réuni plus de 14 000 soldats en mai 2025. En 2023, 4 bases supplémentaires ont été désignées dans le cadre de l’Enhanced Defense Cooperation Agreement, portant à 9 le nombre de sites militaires accessibles aux forces américaines. En 2024, un accord de
partage de renseignements (GSOMIA) a également été signé, consolidant la coopération stratégique entre les deux pays. Ces liens militaires étroits placeraient l’archipel en première ligne en cas de crise à Taïwan, voire pire, de guerre sino-américaine de haute intensité dans le Pacifique. Dans un tel environnement, des liens sécuritaires de plus en plus étroits sont en passe de se nouer entre Manille et d’autres partenaires pro-américains de la
zone (Japon, Corée du Sud, Australie).
Centrale dans la stratégie américaine de containment de la Chine fondée sur le concept de First Island Chain, la relation entre Manille et Washington s’avère très déséquilibrée au profit des États-Unis. La politique commerciale de Donald Trump, notamment sur les droits de douane, menace les intérêts philippins alors que les États-Unis représentent le 1 er excédent commercial du pays (3,3 milliards de dollars en 2024). Un accord annoncé en
juillet 2025 prévoit l’exonération des produits américains sur le marché philippin, tandis que les exportations philippines seraient taxées à 19% (un taux plutôt « supportable » comparé à ceux infligés à d’autres pays de la région). Les contours de cet accord restent peu précis à ce stade, mais ce dernier fragilise néanmoins les secteurs dépendants des débouchés américains, comme l’électronique et le cuir, et pourrait aggraver le déficit commercial philippin, les États-Unis étant le 1 er client des Philippines (11,4 milliards de dollars d’exportations en 2024).
*
Par sa dynamique démographique, son potentiel économique et sa position stratégique dans l’Indo-Pacifique, les Philippines incarnent un acteur jusqu’à présent secondaire et marginal (surtout du regard des Européens) de la scène internationale, mais qui est appelé à connaitre un rôle croissant sur divers dossiers au cours des décennies à venir : rivalités sino-américaines, réorganisation des chaines de valeur, évolutions des externalisations résultant de l’économie mondialisée, gestion des océans, accès aux minerais critiques… Ce « rehaussement » géopolitique et géoéconomique
prévisible des Philippines ne doit pas être négligé vue d’Europe et offre des opportunités aux entreprises françaises pour accompagner ces transformations, à l’image des succès récents enregistrés dans le domaine naval (Cf : contrat historique d’Ocea avec les garde-côtes philippins au printemps dernier). Dans le monde actuel si complexe et si agité, comment passer à côté d’un marché si dynamique et fort de de près de 120
millions de consommateurs ?