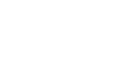Horizon 2035 est très heureux de vous présenter une nouvelle contribution de Matthieu Lohse, qui poursuit son exploration des projets politico-urbains futuristes tendant à émerger dans l’Hémisphère occidental. Après nous avoir présenté en mars le projet de Silica City au Guyana, il nous propose cette fois-ci un coup de projecteur sur Prospera, une enclave ultra-libertarienne implantée au Honduras et soutenue par plusieurs magnats de premier plan de la Sillicon Valley. Matthieu est un fin connaisseur des enjeux latino-américains. Il est diplômé de Sciences Po Strasbourg et de Sorbonne-Nouvelle en relations internationales et suit avec attention les évolutions géopolitiques, démographiques, technologiques et militaires des pays de la région.
Sur l’île de Roatán, au large des côtes du Honduras, une ville nouvelle tente de s’affranchir des contraintes étatiques. Son nom : Prospera. Ses promoteurs la présentent comme un havre d’innovation, une cité d’un genre inédit où les règles du monde seraient réécrites au profit de la liberté individuelle et de la prospérité économique. Mais derrière cette ambition, c’est une idéologie bien plus vaste qui se déploie, celle d’un libertarianisme radical, prêt à bouleverser l’ordre mondial et les équilibres démocratiques.
Prospera, laboratoire libertarien ou enclave néocoloniale ?
Créée en 2017 grâce à une réforme constitutionnelle controversée, Prospera est une Zone pour l’Emploi et le Développement Économique (ZEDE), un territoire presque entièrement soustrait à la juridiction du Honduras. Dans cette cité privée de deux kilomètres carrés, les lois, la police, les tribunaux, la fiscalité et tous les services publics sont administrés par des entités privées. Les réglementations nationales en matière d’environnement, de commerce ou de droit civil n’y trouvent guère d’écho.
En théorie, Prospera promet une floraison d’opportunités économiques et un terreau fertile pour les entreprises innovantes. Les résidents peuvent s’y installer facilement en souscrivant un abonnement annuel de 1 300 dollars, bien moins pour les Honduriens. Le système d’adhésion est conditionné à la réputation et à l’alignement idéologique avec les principes fondateurs de la ville. Les « communistes » en sont par exemple exclus. Prospera a été dessinée pour environ 10 000 habitants. À ce jour, quelques 2 200 personnes y ont obtenu le statut de résidents, sans pour autant y séjourner 365 jours par an.
Mais sous cette façade de country club tropical pour VIP se cache une réalité bien plus complexe. Prospera est devenue un terrain d’expérimentation pour des technologies et des pratiques interdites ailleurs : implants d’aimants sous-cutanés, administration de molécules controversées, comme la follistatine, censée prolonger la vie, essais cliniques de traitements contre le VIH en dehors de tout cadre éthique international. Le village de Vitalia, qui s’installe chaque hiver dans la zone, attire transhumanistes, biohackers, ingénieurs et investisseurs fascinés par l’idée de « rendre la mort optionnelle ». On y retrouvera notamment le gourou américain Bryan Johnson, fer de lance de la quête de l’immortalité.
La promesse d’un monde débarrassé des entraves étatiques attire une clientèle mondiale. Mais à quelques centaines de mètres de là, dans le village de Crawfish Rock, la résistance s’organise. Les habitants dénoncent l’accaparement des ressources, la privatisation des accès à l’eau, la destruction de la mangrove et les menaces environnementales qui pèsent sur leur quotidien. Pour certains, Prospera est une opportunité. Pour d’autres, elle est l’héritière directe des concessions néocoloniales du siècle passé, celles des compagnies bananières qui ont marqué l’histoire douloureuse de l’Amérique centrale.
Prospera, bien que présentée comme un projet hondurien, est en réalité contrôlée par des investisseurs libertariens et ultralibéraux étrangers, notamment Erick Brimen, Gabriel Delgado Ayau, Patri Friedman et, le plus connu d’entre eux, Peter Thiel, via une société enregistrée dans le paradis fiscal du Delaware. Son développement est soutenu par des réseaux internationaux et lié à des figures majeures de l’extrême droite économique mondiale comme l’Argentin Alejandro Chafuen ou l’Autrichienne Barbara Kolm, figure de proue du parti d’extrême droite FPÖ, inscrivant le projet dans une stratégie globale de création d’enclaves privées échappant à la souveraineté des États.
Une idéologie globale : le libertarianisme à l’assaut des nations
En effet, Prospera n’est pas une curiosité isolée. Elle est l’expression aboutie, la mise en œuvre concrète d’une idéologie néolibérale-libertarienne, souvent associée au mouvement anarcho-capitaliste, qui rêve de réduire l’État à sa plus simple expression. Ce courant, influencé par des penseurs comme Milton Friedman ou par les travaux du prix Nobel Paul Romer sur les « charter cities », considère que l’État est avant tout un obstacle à la prospérité.
L’un des principaux architectes de Prospera, Patri Friedman, petit-fils de Milton, s’est illustré par ses projets de cités flottantes autonomes portés par le Seasteading Institute. Avec le soutien financier de Peter Thiel, cofondateur de PayPal et figure centrale du libertarianisme technologique, ces projets visent à créer des enclaves capables d’échapper à toute souveraineté étatique.
Peter Thiel incarne une pensée radicale : celle d’un monde où la démocratie serait une faiblesse, où la liberté se mesure à la capacité de contourner les règles communes. Proche des milieux de la « Dark Enlightenment » – un courant technocratique et élitiste prônant la gouvernance par des élites déconnectées des masses et dont le chef de file intellectuel est l’informaticien-blogueur Curtis Yarvin – Thiel investit massivement dans des villes comme Prospera via son fonds Pronomos. L’objectif est de bâtir – un peu partout à travers la planète (en Afrique, en Asie du Sud, dans le Pacifique ou en Méditerranée) – un réseau de micro-sociétés où le marché pourra sans entrave dicter sa loi et où l’innovation technologique peut s’épanouir sans barrière réglementaire.
Ce mouvement ne se limite pas à quelques milliardaires californiens. Il s’appuie sur des réseaux structurés comme l’Atlas Network, organisation libertarienne influente dans plus de 100 pays, qui finance et conseille de nombreux dirigeants en Amérique latine, en Afrique et en Europe. Le réseau, fondé en 1981 par Antony Fisher, vise à répandre à l’échelle mondiale une idéologie de marché radicalement libérale, reposant sur la primauté de l’individu, la propriété privée, le libre-échange et la déréglementation systématique de l’économie. Son objectif central est de réduire au minimum le rôle de l’État, qu’il considère comme inefficace, voire nuisible, et de favoriser une société régie par la concurrence, l’entrepreneuriat et la responsabilité individuelle.
À la tête du financement de ce réseau se trouve Charles Koch, magnat américain de l’énergie et copropriétaire du conglomérat Koch Industries, dont la fortune s’est construite sur le pétrole, la chimie et les services financiers. Patron discret mais influent, Koch est devenu l’un des architectes les plus puissants de l’ultralibéralisme contemporain, investissant des centaines de millions de dollars dans des think tanks, des campagnes électorales et des universités pour diffuser ses idées. À travers le réseau Atlas, il cherche non seulement à influencer la politique américaine, mais aussi à exporter son modèle idéologique aux quatre coins du globe, en ciblant particulièrement les pays en développement et les institutions européennes.
Prospera et ses avatars : la multiplication des villes privées
Prospera n’est que la partie émergée d’un archipel libertarien en pleine expansion. Sur la scène internationale, plusieurs projets concurrents ou complémentaires émergent, tous inspirés par la même volonté de s’émanciper des cadres étatiques traditionnels.
Au Nigeria, le projet Itana entend bâtir une zone technologique autonome, soutenue par Pronomos, Binance et des investisseurs de la Silicon Valley. En Méditerranée, la ville de Praxis promet une gouvernance entièrement crypto-compatible, attirant des capitaux en quête de régulations sur mesure. Au Salvador, le président Nayib Bukele ambitionne de construire Bitcoin City, une ville adossée à un volcan et entièrement dédiée aux cryptomonnaies, où les impôts seraient quasi inexistants. Dollarisé depuis 2001, le Salvador de M. Bukele avait adopté le bitcoin comme monnaie officielle en septembre 2021, devenant la première nation du monde à prendre une telle mesure. Le dirigeant populiste a finalement rétropédalé en février dernier.
L’horizon de ces villes privées s’étend même jusqu’au Groenland, où des donateurs proches de Peter Thiel ont tenté de convaincre Donald Trump de soutenir la création d’un hub technologique offshore, Freedom City. Ces enclaves, plus ou moins avancées, esquissent un monde où les règles varieraient d’un territoire à l’autre, où des îlots de liberté économique extrême côtoieraient des États-nations de plus en plus contestés.
Une contestation grandissante : la souveraineté en péril
Face à cette montée des cités privées, la résistance s’organise. Au Honduras, l’arrivée au pouvoir de Xiomara Castro en 2022 a marqué un tournant. La nouvelle présidente a engagé une procédure d’abrogation des ZEDE, accusées de violer la Constitution et de porter atteinte à la souveraineté nationale. Une plainte a été jugée recevable par la Cour constitutionnelle, mais Prospera a contre-attaqué devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI – Banque mondiale), réclamant une indemnisation de 10,7 milliards de dollars, soit presque la moitié du PIB hondurien.
Cette judiciarisation des conflits est révélatrice d’une tendance lourde : les multinationales et les enclaves privées disposent désormais d’outils juridiques puissants pour contester les décisions souveraines des États. Le recours systématique aux tribunaux d’arbitrage privés, tendance lourde des relations économiques contemporaines au gré de la conclusion d’accords de libre-échange, menace de priver les gouvernements de leur capacité à légiférer librement sur leur propre sol.
Une poussée libertarienne globale : quand la tech rencontre la politique
Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement politique plus large. En Amérique latine, des figures comme Javier Milei, le président argentin, portent haut les couleurs de l’anarcho-capitalisme. Obsédé par la réduction de l’État et par la dollarisation de l’économie, M. Milei ambitionne de privatiser l’ensemble des secteurs publics, de démanteler la banque centrale et de supprimer une grande partie des impôts.
Aux États-Unis, la galaxie libertarienne gravite autour d’une poignée de figures influentes issues de la Silicon Valley, souvent regroupées sous le surnom des « PayPal Mafia » — un réseau d’entrepreneurs ayant fait fortune dans la tech, autour de Peter Thiel, Elon Musk ou encore Reid Hoffman. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, Palantir et Clarium Capital, incarne la jonction entre ultra-libéralisme technologique et activisme politique. Grand mécène du Parti républicain, il a financé et conseillé des figures montantes comme l’ex-sénateur de l’Ohio J.D. Vance devenu vice-président des États-Unis. Elon Musk, quant à lui, est allé bien au-delà d’un simple rapprochement avec Donald Trump : il a dirigé le Département de l’efficacité économique de la Maison Blanche (DOGE), se targuant d’avoir réduit de plus de 175 milliards le budget de l’État fédéral, un chiffre pourtant invérifiable. M. Musk avait auparavant injecté plusieurs dizaines de millions de dollars dans la campagne de réélection de M. Trump, et mobilisé X (ex-Twitter) comme caisse de résonance des thèmes trumpistes. Autour d’eux, des profils comme Jacob Helberg, (ex-conseiller en cybersécurité chez Palantir), partisan d’un capitalisme autoritaire, a été nommé sous-secrétaire d’État au développement économique. On peut aussi citer Michael Kratsios, ancien de Clarium Capital, qui a rejoint la Maison Blanche comme conseiller scientifique du président Trump. Issus de l’entourage de Thiel, ils contribuent à structurer une droite technocratique, nationaliste et profondément méfiante à l’égard de l’État fédéral. Ce noyau d’influence entend réinventer le pouvoir politique à partir des codes de l’entreprise privée, de la souveraineté numérique et du darwinisme économique.
En Europe, le réseau Atlas agit comme une fabrique d’idées libertarienne d’envergure, implantée dans de nombreux pays à travers une constellation de think tanks influents. Ces institutions – telles que l’Institut économique Molinari, l’IREF (Institut de recherches économiques et fiscales), Contribuables associés, ou encore le Consumer Choice Center – promeuvent une vision ultralibérale fondée sur la réduction drastique de l’impôt, la suppression de l’État-providence et la privatisation des services publics. Leur discours défend une fiscalité minimale, l’abolition de l’impôt sur les sociétés, une dérégulation généralisée et une approche radicale de la liberté individuelle qui s’oppose aux politiques sociales et environnementales de l’Union européenne. À Bruxelles, des groupes comme Epicenter ou l’ECIPE (European Centre for International Political Economy) assurent la présence directe de ce courant idéologique dans les cercles du pouvoir européen, en influençant les eurodéputés conservateurs et libéraux à travers des notes de lobbying, des événements et des classements de « performance économique ». Par ailleurs, le réseau agit généralement contre les politiques climatiques, contestant la légitimité des régulations environnementales en les présentant comme des atteintes aux libertés individuelles et aux choix du consommateur. Des personnalités comme Cécile Philippe (Institut Molinari), Nicolas Lecaussin (IREF), Fred Roeder (Consumer Choice Center) ou Barbara Kolm (FPÖ autrichien) incarnent ce courant, mêlant expertise médiatique et activisme idéologique.
Un monde fragmenté : quels futurs possibles ?
La montée en puissance des cités privées et des zones autonomes redessine les frontières de la mondialisation. Ces enclaves attirent capitaux, talents et technologies, tout en échappant aux mécanismes classiques de régulation. Elles promettent des fiscalités ultra-légères, des juridictions sur mesure, et des écosystèmes favorables à l’innovation radicale, notamment dans la cryptomonnaie, la biotech et l’intelligence artificielle.
Ces territoires risquent de devenir des paradis réglementaires (ou plus exactement déréglementés) où s’amplifient les inégalités, où la notion même de citoyenneté perd son sens, et où les États peinent à protéger leurs populations. Ces zones pourraient aussi servir de levier géopolitique, permettant à des puissances économiques, via des structures privées, de s’implanter durablement dans des régions stratégiques pour en extraire des ressources, au détriment des souverainetés locales : au Groenland, demain en Antarctique, en haute mer pour prospérer sur l’exploitation minière des profondeurs, voire un jour sur la Lune ? L’imbrication entre ces cités utopiques – ou dystopiques – et les intérêts privés de leurs promoteurs, et de leurs entreprises de la tech, pourrait venir rebattre les cartes de l’économie mondial : nous dirigeons-nous dès lors vers un monde gouverné par la loi du plus fort ?
À terme, ces cités pourraient s’interconnecter, formant une sorte d’Internet des villes, régies par des protocoles numériques et des contrats intelligents (smart contracts), renforçant leur indépendance vis-à-vis des gouvernements nationaux et des États. Le droit, codé, pourrait progressivement remplacer les législations classiques, contribuant à une fragmentation juridique mondiale.
Face à ces mutations, la communauté internationale doit choisir entre deux voies : soit accepter la multiplication de ces enclaves comme une évolution naturelle de la mondialisation, au risque de voir les inégalités et les tensions géopolitiques s’exacerber ; soit chercher à construire de nouveaux instruments de régulation globale, capables de garantir des standards minimaux en matière de droits sociaux, environnementaux et fiscaux.
Les résistances locales, comme celles observées à Crawfish Rock, pourraient se multiplier, cristallisant un rejet croissant des projets perçus comme des enclaves pour ultra-riches, coupées des réalités sociales. Dans ce contexte, la capacité des États à affirmer leur souveraineté et à protéger l’intérêt général devrait être déterminante.
Prospera, utopie fragile ou dystopie glaçante ?
Pour l’heure, Prospera reste une expérimentation fragile, menacée par l’instabilité politique, les contentieux juridiques et la contestation populaire. Mais l’idéologie qu’elle incarne est loin d’être marginale. Elle s’inscrit dans une dynamique profonde où des acteurs privés puissants, convaincus que la liberté individuelle prime sur toute autre considération, cherchent à s’extraire des cadres étatiques pour bâtir des mondes à leur image. L’avenir de ces cités libertariennes, et plus largement des zones privées transnationales, interroge : sont-elles les laboratoires du futur ou les symptômes d’une gouvernance mondialisée, réservée aux plus fortunés et qui échappe déjà aux peuples ? La question reste ouverte et s’annonce comme l’un des grands débats géopolitiques des décennies à venir
Matthieu Lohse