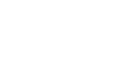Le recul spectaculaire de l’influence française en Afrique constitue une dimension majeure du bilan diplomatique du Président Macron. La nature « géopolitique » ayant horreur du vide, ce déclin tricolore dans de vastes pans de son « Pré carré » a rapidement été comblé par divers compétiteurs aux ambitions africaines affirmées : Chine, Russie, Turquie, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Qatar, Inde, Pakistan… La liste est longue, à laquelle on rajoutera, profitant d’une telle aubaine, certains partenaires occidentaux ou européens, certes alliés mais vrais concurrents : Etats-Unis, Royaume-Unis, nos bons amis allemands et surtout, nos très chers voisins italiens. C’est ce dernier point, souvent mal perçu depuis Paris, qu’Horizon 2035 se propose de décortiquer dans ce nouvel article, via une nouvelle contribution de Bassem Laredj. Bassem est docteur en droit international, analyste stratégique et enseignant universitaire en Droit international et Relations internationales. Il est également président- fondateur du cabinet de conseil Amane Risk Consulting, spécialisé en Renseignement d’affaires et Risque pays.
Si l’Afrique fait face à de nombreux défis (socio-économiques, sécuritaires, environnementaux…) incitant une partie de sa jeunesse à chercher à rejoindre l’Europe à n’importe quel prix, le continent abrite en même temps un potentiel économique considérable. Cette dualité africaine engendre des sentiments ambivalents d’appréhension et d’attrait. Dans sa volonté de se distinguer des autres acteurs internationaux présents en Afrique, souvent critiqués pour leurs approches « prédatrices » et « néocoloniales », l’Italie sous la direction de Giorgia Meloni adopte officiellement une posture différente, se voulant plus pragmatique et équilibrée.
Cette stratégie vise à concilier les intérêts nationaux italiens avec ceux des nations africaines dans une dynamique mutuellement bénéfique, obéissant à une logique « gagnant-gagnant ». Le point de départ de cette stratégie a été officiellement lancé à Rome, en janvier 2024, à l’occasion du Sommet Italie-Afrique, qui a permis d’établir les jalons d’un partenariat « d’égal à égal » entre l’Italie et les pays africains, rompant avec les relations asymétriques postcoloniales qui ont longtemps caractérisé les relations des États africains avec les Occidentaux, et tout particulièrement la France. Pour symboliser cet engagement italien envers des relations plus équilibrées avec les partenaires africains, ce programme a été baptisé « Plan Enrico Mattei ». Une appellation pleine de symbole car faisant référence au fondateur du géant énergétique italien « ENI » qui, dans les années 1950, avait instauré des contrats pétroliers plus équitables pour les pays en développement producteurs d’hydrocarbures que ceux proposés par les autres grandes compagnies énergétiques anglo-saxonnes ou françaises , avant de décéder dans un mystérieux accident d’avion, en 1962.
Par le biais du Plan Mattei, tout en cherchant à renforcer les relations bilatérales de son pays avec les pays africains, Giorgia Meloni poursuit trois objectifs fondamentaux visant à baliser les relations italo-africaines pour les dix ans à venir et au-delà : endiguer l’immigration irrégulière depuis l’Afrique vers l’Italie (1) en favorisant le développement économique des pays partenaires (2), tout en renforçant l’influence diplomatique et commerciale italienne sur le continent noir.
Endiguer l’immigration clandestine
La problématique de l’immigration clandestine en Italie constitue depuis de nombreuses années un enjeu politique majeur et une source de divisions sociétales. Les positions fermes de Meloni sur ce dossier avaient d’ailleurs largement contribué à la victoire de son parti aux législatives de 2022, conduisant à son arrivée à la tête du gouvernement italien. Face au défi migratoire, accentué par la configuration géographique italienne caractérisée par un littoral étendu difficilement contrôlable et la proximité avec l’Afrique septentrionale, le gouvernement Meloni développe une double stratégie.
D’abord, il cherche à délocaliser la gestion des flux migratoires via des accords bilatéraux avec des pays tiers comme la Libye et la Tunisie, principaux points d’embarquement depuis l’Afrique des migrants irréguliers vers l’Italie. Ainsi, selon le ministre de l’Intérieur italien Matteo Piantedosi, grâce à ces accords « les départs de 192.000 migrants irréguliers en provenance de Libye et de Tunisie » à destination des côtes italiennes ont été bloqués entre 2023 et 2024.
Néanmoins, ces accords font l’objet de vives critiques de la part d’ONG de défense des droits humains, qui dénoncent les conditions de détention des migrants, particulièrement dans les centres libyens, où des violations des droits fondamentaux sont régulièrement signalées, sans parler des exactions commises en mer par les garde-côtes libyens contre les embarcations tentant de rejoindre la Péninsule.
Ensuite, le gouvernement Meloni cherche à construire des partenariats économiques solides avec les pays africains pour qu’ils puissent se développer et offrir de nouvelles perspectives aux jeunes tentés de migrer, et ainsi combattre en amont les causes à l’origine d’une grande partie de l’immigration clandestine. C’est dans ce cadre que le Plan Mattei prend toute son importance stratégique pour l’Italie. La Première ministre, prône en effet une approche « d’égal à égal » qui abandonne l’attitude prédatrice vis-à-vis du continent pour juguler les flux migratoires. Si certains estiment que le Plan Mattei vise davantage à favoriser les intérêts des entreprises italiennes sur le continent africain qu’à promouvoir le développement des nations africaines et le bien-être de leurs populations, ce dernier a été accueilli favorablement par la majorité des gouvernements africains partenaires.
Il convient désormais d’évaluer si l’Italie dispose des ressources nécessaires pour concrétiser ses ambitions en Afrique. Les ressources financières que l’Italie peut mobiliser pour réaliser les projets annoncés demeurent insuffisantes et inadéquates pour atteindre l’un des objectifs proclamés, à savoir que ces investissements contribuent à endiguer les flux migratoires en générant des emplois et de la prospérité économique dans les pays d’origine. La question migratoire ne se résume pas à une simple question économique ou financière, mais présente de multiples facettes (climat, guerre, corruption…). Cet objectif prioritaire du Plan Mattei ne pourra être véritablement réalisé qu’à travers une coopération intensive avec l’Union européenne (UE) et les institutions financières internationales, ainsi qu’une approche globale permettant de répondre efficacement aux aspirations des populations africaines. Dans cette perspective, le suivi rigoureux des projets lancés s’avère fondamental.
Soutien aux économies africaines
Alors qu’à l’origine le Plan Mattei ciblait neuf pays africains (Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Kenya, Mozambique et Congo-Brazzaville), celui-ci a été élargi par la suite à cinq nouveaux partenaires (Angola, Ghana, Mauritanie, Sénégal et Tanzanie), portant à 14 le nombre de pays africains bénéficiant actuellement de l’appui italien dans le cadre de cette initiative. Sur le plan financier, la Présidente du conseil italien, a indiqué en juin dernier qu’une enveloppe de 5,5 milliards d’euros a été allouée pour soutenir différents projets dans les pays partenaires. Cette initiative vise à encourager les investissements des entreprises italiennes en Afrique, à faciliter les transferts technologiques et à valoriser les ressources locales.
Si, historiquement, le secteur énergétique a été (et reste) au centre de la coopération italienne avec les pays africains, notamment l’Algérie, la Libye et le Congo-Brazzaville, de nouveaux domaines de coopération émergent désormais dans le cadre du Plan Mattei. À ce jour, plus d’une vingtaine de projets ont été déployés sur le continent africain dans le cadre de cette initiative. Au-delà du secteur énergétique, les projets italiens se concentrent notamment sur le développement agricole, la formation professionnelle, l’éducation, la santé et les infrastructures. Ainsi, dans le domaine agricole, plusieurs initiatives sont actuellement en développement. Parmi celles-ci, un programme de réhabilitation des terres semi-arides est mené en Algérie par l’entreprise Bonifiche Ferraresi avec l’appui financier de Simest. En Côte d’Ivoire, Sace a lancé un projet visant à consolider certaines filières agricoles locales destinées au marché intérieur. Au Kenya, un projet en cours qui pourrait impliquer jusqu’à 200.000 petits agriculteurs vise l’extension de la production d’huile végétale pour les biocarburants. Le Mozambique bénéficie également d’un investissement italien de 38 millions d’euros pour l’établissement d’un pôle agroalimentaire dans la province centrale de Manica. Cette infrastructure, stratégiquement située pour faciliter l’exportation, sera dédiée à la transformation, conservation et conditionnement des produits agricoles de toute la province, laquelle aspire à devenir un pôle agro-industriel de référence.
Plusieurs programmes de formation ont également été annoncés ou lancés. La Côte d’Ivoire, par exemple, bénéficiera d’un programme visant à améliorer les infrastructures scolaires et la formation pédagogique dans diverses régions. En Égypte, un soutien est prévu pour l’école hôtelière italienne Enrico Mattei à Hurghada, inaugurée en octobre 2024, afin de développer l’enseignement touristique et d’optimiser la gestion des migrations professionnelles et la coopération dans la gestion des flux migratoires liés au travail. Au Maroc, un projet financé par la Fondation Enel, porte sur la création d’un centre de formation spécialisé dans les énergies renouvelables et la transition énergétique. En Tunisie, l’entreprise italienne Terna a créé un centre de formation et d’accélération technologique pour les entreprises innovantes du secteur de l’énergie. Par ailleurs, l’Italie s’est engagée à former de hauts fonctionnaires africains. Au total, 1 360 étudiants originaires de quatre pays pilotes (Tunisie, Côte d’Ivoire, Kenya et Éthiopie) bénéficieront d’une formation approfondie de 36 mois en Italie à l’École nationale d’administration (Sna). Cette initiative vise à doter les futurs dirigeants des administrations publiques africaines de compétences et d’aptitudes managériales en phase avec les objectifs européens et les défis internationaux contemporains, notamment dans les domaines de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.
Enfin, dans le domaine des infrastructures stratégiques, l’Africa Finance Corporation (AFC) a bénéficié en juin dernier d’un financement de 250 millions d’euros, échelonné sur dix ans, accordé par Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’institution financière italienne pour la coopération au développement. Cette opération financière est sécurisée à 80% par SACE, l’organisme italien d’assurance et de financement sous tutelle intégrale du ministère italien de l’Économie et des Finances. Ce prêt vise notamment à soutenir le développement du corridor de Lobito, une infrastructure stratégique transfrontalière reliant des zones minières de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Zambie au port atlantique de Lobito, en Angola. Le soutien italien à ce projet vient en appui à la stratégie d’investissement global du G7 en Afrique, visant à développer des infrastructures critiques dans le continent africain, pour contrebalancer l’influence croissante de la Chine. Pour rappel, le corridor de Lobito doit relier par route et voie ferroviaire sur 1300 km l’océan Atlantique aux zones minières du Copperbelt, situées à la frontière entre la RDC et la Zambie, avec une extension potentielle vers la Tanzanie. Ce projet devrait reconfigurer les échanges commerciaux régionaux en offrant un acheminement plus efficace et sécurisé des minerais stratégiques vers les marchés internationaux via le port angolais. Sa réalisation contribuera à renforcer la connectivité régionale, à générer des emplois et à promouvoir une croissance économique durable dans une zone où les infrastructures ferroviaires sont largement insuffisantes au regard des besoins miniers et commerciaux.
Un levier d’influence géopolitique et économique
L’initiative italienne pour l’Afrique constitue enfin un véritable enjeu d’influence internationale, non seulement pour l’Italie mais également pour l’UE qui manifeste un intérêt croissant pour le Plan Mattei. En effet, Bruxelles semble voir dans ce plan une opportunité d’accroître son influence sur le continent africain, au moment où l’influence française ne cesse d’y reculer. Cet intérêt s’est concrétisé le 20 juin dernier lors d’un sommet coprésidé par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Giorgia Meloni, durant lequel la responsable européenne a officiellement soutenu le plan italien. L’ambition déclarée est d’harmoniser le Plan Mattei avec la stratégie européenne « Global Gateway » lancée en 2021, sensée favoriser d’importants investissements en Afrique. Rappelons que cette initiative européenne dotée de 150 milliards d’euros a été mise en place pour tenter de contrer le programme chinois des « Nouvelles routes de la soie ».
Bien que le projet italien, doté de 5,5 milliards d’euros, soit financièrement bien plus modeste que le programme européen, l’attention que Bruxelles porte à l’engagement italien en Afrique relève principalement de considérations stratégiques et diplomatiques. En effet, le passif colonial de l’Italie en Afrique est beaucoup moins marqué que d’autres Etats européens, et tout particulièrement de la France qui est souvent accusée de « paternalisme » et d’ingérence dans les affaires de ses ex-colonies. En se référant à « l’héritage Matteï », aux relents vaguement tiers-mondistes, Rome affirme sa volonté d’entretenir des relations avec les Etats africains dépourvues de toute condescendance ou paternalisme. Une allusion à peine dissimulée aux pratiques longtemps mises en œuvre à Paris et qui ne passent plus au sein des nouvelles générations africaines, rejet s’étant traduit par un recul significatif de son influence ces dernières années, notamment dans les régions sahéliennes et maghrébines, traditionnellement considérées comme relevant de sa sphère d’influence. Ainsi, sur le plan diplomatique, l’Italie apparaît désormais, tant à Bruxelles que dans de nombreuses capitales africaines, comme un interlocuteur potentiellement plus acceptable pour représenter et porter les intérêts européens en Afrique.
La convergence des objectifs stratégiques du Plan Mattei avec ceux du programme « Global Gateway » permet aussi à l’Italie d’obtenir un appui européen substantiel, notamment sur le plan financier. À travers ce soutien, l’Italie peut mettre en œuvre à la fois ses propres projets sur le continent africain mais aussi se greffer sur des projets européens en cours et ainsi renforcer son rôle d’intermédiaire privilégié entre l’Europe et l’Afrique, mais aussi les banques multilatérales de développement et le secteur privé. Cette stratégie, qui renforce considérablement l’influence internationale de l’Italie, notamment sur le continent africain, favorise l’expansion des activités de ses entreprises en Afrique, à l’image du géant énergétique ENI, de l’opérateur de réseau électrique Terna, du groupe agro-industriel Bonifiche Ferraresi ou de la société de câbles sous-marins Sparkle. Cette dernière, par exemple, est chef de file du projet du câble sous-marin Blue Raman, cofinancé par la Commission européenne. Ce câble doit permettre d’améliorer la connectivité entre l’Europe, l’Afrique et l’Inde. Sur le plan agricole, l’initiative TERRA soutenue par une contribution de l’UE à hauteur de 109 millions d’euros, vise à renforcer les systèmes agroalimentaires durables en Afrique de l’Est. Sur le terrain, cette initiative est menée principalement par le ministère italien des Affaires étrangères avec l’ONUDI.
Malgré les ambitions affichées par les promoteurs du Plan Mattei, plusieurs défis restent à surmonter par l’Italie pour rendre son initiative crédible et viable sur le long terme. En dehors de l’aspect financier qui reste pour l’heure d’un niveau très limité pour atteindre les objectifs annoncés, il y a également la question de la gouvernance des projets. En effet, sans mécanismes de contrôle transparents, les projets annoncés risquent de ne pas aboutir ou de ne pas donner les résultats escomptés. L’Italie devra également veiller à continuer sur la durée à respecter son engagement d’un partenariat « égal à égal » avec les pays africains afin d’éviter toute accusation de « néocolonialisme » susceptible de fragiliser sa présence et celle de ses entreprises en Afrique. S’ajoutent à cela les tensions qui peuvent exister entre membres de l’UE à propos de certains dossiers africains et qui peuvent impacter négativement la dynamique italienne actuelle en Afrique.
* * *
Une meilleure coordination des actions de l’UE et de l’Italie en Afrique s’impose alors que les défis intriquant Europe et Afrique au cours de la décennie à venir s’annoncent aussi nombreux que préoccupants (pression migratoire, crise environnementale, stress hydrique, pollution marine, insécurité alimentaire, sécurisation des approvisionnement en matière première, déséquilibre des échanges économiques, rivalités géopolitiques, montée des idéologies extrémistes). Face aux enjeux majeurs qui les attendent, les deux continents voisins ont tout intérêt à trouver une voie commune pour tenter de maîtriser un avenir bien incertain !
Bassem LAREDJ